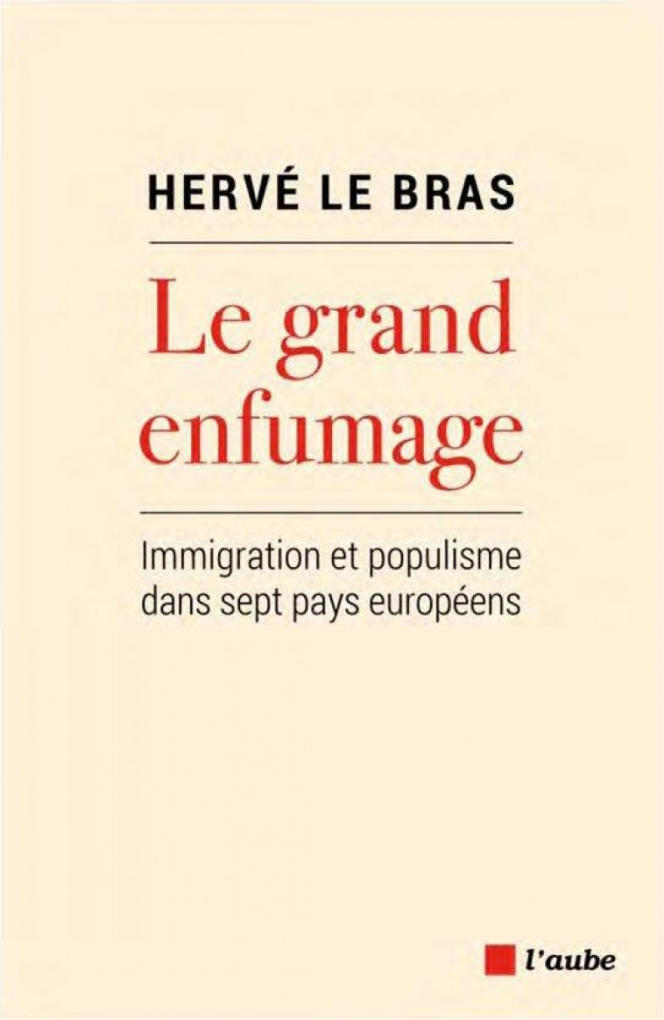Le vote populiste d’extrême droite a souvent pour objet la lutte contre l’immigration, mais il n’est pas lié aux dynamiques migratoires actuelles, analyse, dans un entretien au « Monde », le démographe, qui a étudié la question dans sept pays européens.
Propos recueillis par Julia Pascual publié sur le site lemonde.fr le 02 02 2022
Hervé Le Bras est démographe et directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Dans son ouvrage Le Grand Enfumage. Populisme et immigration dans sept pays européens (Ed. de l’Aube-Fondation Jean Jaurès, parution le 3 février, 168 pages, 17,90 euros), il décrypte les ressorts politiques du vote populiste et démontre que celui-ci n’est pas corrélé à la présence d’immigrés sur le territoire.
En France et dans six autres pays d’Europe, la géographie du vote populiste ne recoupe pas celle de l’immigration. Comment cela se fait-il ?
L’immigration est beaucoup plus présente dans la tête des gens que dans leur existence quotidienne. Ainsi, en 2017, en France, il y avait, selon l’Insee, 3,8 % d’immigrés dans les communes de moins de 2 500 habitants, alors que le vote pour [la candidate du Rassemblement national, RN] Marine Le Pen y avait atteint 27 % au premier tour de l’élection présidentielle. Dans les villes de plus de 20 000 habitants, on comptait 15 % d’immigrés et 14 % de votes pour la candidate frontiste. A Paris, il y avait 23 % d’immigrés et seulement 5 % de vote pour Le Pen. La Seine-Saint-Denis, département avec la plus forte proportion d’immigrés (30,6 %), avait voté Le Pen à 13,6 %. L’Aisne, département où le vote frontiste était le plus fort (35,7 %), ne comptait que 4,4 % d’immigrés.
La situation est à peu près la même dans les six autres pays d’Europe. En Suisse, par exemple, l’Union démocratique du centre (UDC, populisme d’extrême droite) recueille 12 % des suffrages dans les grandes villes, 24 % dans les villes moyennes et 34 % dans les zones rurales, alors que les grandes villes abritent 35 % d’étrangers, les moyennes, 22 %, et les zones rurales, 12 %.
Le vote populiste répond-il davantage à une géographie socio-économique ?
Les régions où le chômage est le plus élevé votent parfois davantage pour l’extrême droite, parfois non. En Allemagne, le chômage est plus répandu à l’Est, où le vote pour Alternative pour l’Allemagne (AfD) est le plus fort. A contrario, en Italie, il se concentre au sud du pays alors que la Ligue triomphe au Nord.
En France, à l’échelon large des régions, il y a une correspondance entre taux de chômage et vote RN. Mais, plus localement, la relation s’inverse. Alors que les villes votent nettement moins pour le RN, le chômage y est en moyenne un peu plus élevé.
La géographie de la migration, elle, obéit bien à une logique économique…
Les immigrés visent les zones urbaines dynamiques dans lesquelles ils peuvent trouver un emploi. A la longue, ils attirent des proches, qui s’installent aux mêmes endroits. Lorsque les centres de l’économie changent, ils ne se relocalisent guère et ce sont des immigrés d’autres origines qui arrivent ou sont appelés.
Ainsi, les Bengalis que l’Angleterre avait fait venir pour ses usines de textile sont restés dans les Midlands après la faillite de cette industrie, tandis que des Polonais et des Lituaniens étaient embauchés dans le high-tech de la région londonienne.
La forte demande dans les services à la personne des classes aisées résidant dans les grandes villes y attire aussi les immigrés. C’est par exemple le cas des femmes roumaines et philippines dans les villes italiennes de Rome et Milan. La mécanique de la migration n’a donc pas de rapport avec celle de la politique.
Par quel mécanisme le vote d’extrême droite répond-il à une logique politique ?
Le vote populiste renvoie à des découpages anciens, qui ont un rapport avec la constitution des pays. En Espagne, le parti Vox, apparu en 2014, a d’abord récolté des suffrages en Castille et en Aragon, au cœur du pays, par opposition aux séparatismes de la Catalogne et du Pays basque. En Italie, les populismes sont présents au sein de la Ligue, qui demande l’autonomie, puis l’indépendance, de la Padanie [région englobant la vallée du Pô et plus largement le nord de l’Italie]. Le fondateur de la Ligue, Umberto Bossi, prétend ainsi que les Italiens du Nord descendent des Celtes et ceux du Sud des Etrusques et des Africains.
En Allemagne, la délimitation entre vote fort et vote faible pour l’AfD coïncide exactement avec l’ancienne frontière séparant l’Allemagne de l’Est de celle de l’Ouest. Au Royaume-Uni, le vote contre le Brexit était concentré en Ecosse, dans la fraction catholique de l’Irlande du Nord et dans l’ouest du Pays de Galles. En Suisse, les cantons ruraux du centre, les premiers à former une confédération au XIVe siècle, votent massivement pour l’UDC, les autres cantons alémaniques un peu moins, et les cantons romands, francophones, encore moins.
Vous opposez la France des champs ouverts, populiste, à celle du bocage…
Aussi étrange que cela paraisse, la carte départementale du vote RN (et Front national, car elle est stable) est celle qui sépare ces deux types de paysages. La coupure remonte au haut Moyen Age avec, d’une part, les bocages à l’Ouest et au Sud-Ouest, et leur population éparpillée en fermes isolées et hameaux, et, d’autre part, les champs ouverts au Nord-Est et dans la zone méditerranéenne, et leur population concentrée dans des villes et villages.
L’historien et médiéviste Marc Bloch (1886-1944) a montré que cette géographie a créé deux types de sociabilités radicalement différentes, et le géographe et sociologue André Siegfried (1875-1959) en a fait l’un des trois facteurs explicatifs de son Tableau politique de la France de l’Ouest sous la IIIe République (Armand Colin, 1913).
La différence entre ces deux pays tient notamment au retard de l’agriculture du bocage, donc à celui de l’industrie. Tandis que cette dernière est entrée en crise au Nord-Est, où elle était ancienne, elle s’est développée à l’Ouest, particulièrement dans le domaine alimentaire au cours du demi-siècle passé. Les enfants des paysans sont devenus assez récemment ouvriers, puis employés et cadres. A l’Est, l’ascension sociale a stagné, les paysans étaient devenus ouvriers dès la première moitié du XXe siècle, puis la situation s’est détériorée à la fin des « trente glorieuses ». A l’Ouest, désenclavement et ascension sociale ont créé des attentes positives. A l’Est, au contraire, la dissolution des liens de sociabilité dans l’habitat groupé et la désindustrialisation ont alimenté une atmosphère anxiogène.
Pourquoi le vote populiste ravive-t-il ces fractures immémoriales ?
Pour exister, les populistes ne peuvent pas occuper la place des partis politiques habituels, qui ne laissent pas d’espace aux nouveaux venus. Il y a là une logique presque d’épidémiologie. Quand le vote populiste se répand, il va cogner contre les bastions des partis anciens. Il prend donc pied sur d’autres terrains. Et pour trouver un principe de rassemblement, il ravive un passé lointain.
Le populisme a nécessairement besoin de s’appuyer sur la fiction d’un peuple homogène – fiction qu’il retrouve dans une histoire souvent fantasmée, fiction de la Padanie, de l’Espagne unifiée, du Royaume-Uni opposé à l’Europe, de la Suisse originelle des cantons d’Uri, de Schwyz, de Zoug, de Glaris, d’Obwald, de l’identité française.
Comment expliquez-vous la prépondérance d’un vote populiste rural ?
C’est une des conséquences de la hausse remarquable du niveau d’éducation et du nombre de diplômés dans tous les pays considérés. Le niveau d’éducation atteint par les individus ne correspond plus aux positions qu’ils occupent dans la société. Le cas exemplaire de la France aide à saisir le problème. Au recensement de 1968, on comptait 6 % de cadres et de professions libérales, et, en parallèle, 6 % de personnes ayant poursuivi des études après le bac. Celles-ci pouvaient donc légitimement aspirer à devenir cadres. Actuellement, et c’est le signe d’un progrès, 36 % des actifs ont suivi des études supérieures, mais on compte seulement 16 % de cadres et de professions libérales, ce qui limite les attentes.
Cet écart est plus fort dans les zones rurales que dans les grandes zones urbaines. Ainsi, dans les communes de moins de 1 000 habitants, 20 % des titulaires du baccalauréat sont cadres, contre 45 % dans les villes de plus de 100 000 habitants. Cela engendre une assez grande insatisfaction dans le monde rural. Les gens ont l’impression d’avoir fait des études pour rien.
Pourquoi ce populisme, qu’il soit français, italien, autrichien ou encore britannique, s’est-il fixé sur le rejet de l’immigration ?
Dans la plupart des pays, la position anti-immigrés s’est construite progressivement. Au départ, Vox était anticatalan et antibasque, les partisans du Brexit n’étaient pas anti-immigrés et le Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ) était avant tout libéral. En Italie, la Ligue d’Umberto Bossi était initialement préoccupée par l’indépendance de la Padanie.
Puis on observe à chaque fois un tropisme de plus en plus marqué pour un discours anti-immigrés. Car, au fond, le seul moyen qu’ont les populistes de se constituer comme peuple, c’est en se définissant par leur contraire, leur ennemi, pour reprendre la définition classique de la politique par Carl Schmitt [1888-1985]. Parce qu’on ne peut pas définir le peuple, on définit son opposé. Chez les populistes de gauche, c’est l’oligarchie, tandis que chez les populistes de droite, ce sont les immigrés.
Vous publiez, le 2 mars, chez Grasset, un essai intitulé « Il n’y a pas de “grand remplacement” », reprenant le nom d’une théorie raciste prisée par l’extrême droite. Qu’en est-il ?
La crainte d’un « grand remplacement » est stupide. Quand vous faites une projection de population, vous n’obtenez jamais un résultat tel que la population immigrée deviendrait majoritaire, même en supposant que tous les descendants d’immigrés et ceux issus des couples mixtes appartiennent à cette population remplaçante. On est dans un fantasme entretenu par le mépris des statistiques, qui est inséparable du populisme pour qui, systématiquement, le cas particulier devient le cas général.