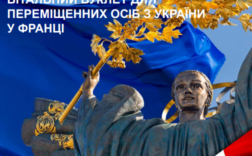La première est en couverture de Vogue, le second du GQ allemand en tant qu’homme de l’année, le troisième a remporté le Goncourt 2021, et le film d’Audiard est garanti zéro stéréotype sur les femmes et les Noirs.
article par Titiou Lecoq publié sur le site slate.fr, le 05 11 2021
En ces temps difficiles, il faut mettre un point d’honneur à célébrer les bonnes nouvelles. Or précisément, cette semaine, j’ai détecté pour vous une conjonction d’informations réjouissantes. D’abord, il y a eu cette couverture magnifique du Vogue français avec Aya Nakamura.
 Mais quelle beauté, cette couv!
Mais quelle beauté, cette couv!
Et, tiens, rigolo, une autre couv a circulé dans mes radars au même moment, celle du GQ allemand qui fait d’Omar Sy l’homme de l’année.

Mais quelle beauté également! À noter que cette photo est un hommage à un portrait de Jean-Baptiste Belley, que voici:

Jean-Baptiste Belley par Anne-Louis Girodet (1797). | Château de Versailles via Wikimedia Commons
Et puis, le lendemain de ces publications, il y avait l’annonce du prix Goncourt 2021, remis à Mohamed Mbougar Sarr, écrivain sénégalais habitant à Beauvais, à la grande fierté des Beauvaisiens, comme le raconte cet article.
Qui plus est, on sait désormais qu’ils ne sont pas là de façon transitoire. Ils sont devenus chacun incontournable dans leur domaine, accumulant, concernant Nakamura et Sy, tous les records.
Eh bien ça me fait plaisir, c’est un magnifique pied de nez à l’ambiance dégueulasse du moment. Lors des rencontres en librairie que je fais en ce moment, on me demande souvent ce que je pense de l’état actuel du pays, et je répète que des forces antagonistes sont à l’œuvre et que pour l’instant, aucune ne l’emporte. Alors oui, il y a des sondages terrifiants, mais il y a aussi le succès de ces artistes.
L’oubli menace sans cesse
L’une des choses qui m’a le plus étonnée dans mes recherches sur les femmes a été de découvrir non seulement que les femmes artistes avaient toujours existé (contrairement au mythe de la femme empêchée) mais qu’en plus, un bon nombre d’entre elles avaient connu le succès de leur vivant. Elles ont véritablement été effacées après leur mort. On pourrait se demander s’il n’est pas arrivé la même chose aux Noirs et Noires en France.
Ainsi, j’ai appris récemment que cette année, on fêtait justement les 100 ans du premier Goncourt attribué à un auteur noir. La coïncidence est folle, non? C’était donc en 1921, le roman s’intitulait Batouala et l’auteur était René Maran. Un documentaire vient de lui être consacré que je vous conseille fortement, il est disponible sur France TV (et son roman est réédité pour l’occasion par Albin Michel.)
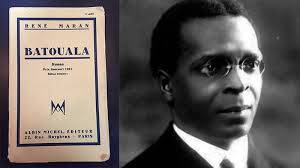
L’exemple de René Maran prouve que sur la route vers l’égalité, rien n’est jamais définitivement gagné. L’oubli menace sans cesse.
Ainsi, à ce triptyque

.. pourrait répondre celui-là, avec trois stars d’une autre époque: Joséphine Baker, Habib Benglia (grand acteur français) et René Maran.

À gauche: Joséphine Baker (1940). | Studio Harcourt via Wikimedia Commons – Au centre: Habib Benglia (1924). | Studio Gilbert-René via Wikimedia Commons
On peut ajouter une boucle dans la boucle (temporelle) avec le fait que la photo d’Omar Sy rappelle donc un révolutionnaire noir français.
Ces figures ne sont pas des exceptions dans le paysage français –ni une nouveauté. (Cela ressortait d’ailleurs très bien dans le livre collectif Histoire mondiale de la France.) Et pourtant, notre mémoire commune tend à les oublier. Il faut donc à la fois célébrer les victoires présentes, et ne plus oublier que d’autres les avaient déjà précédées qui ont été effacées.
Un film où une femme et un Noir ne sont pas «la femme» et «le Noir»
Mais ce n’est pas tout. Cette semaine, je suis allée au cinéma voir Les Olympiades de Jacques Audiard. J’ai eu la joie d’y retrouver la vitalité qui m’avait déjà enivrée dans Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma est coscénariste des Olympiades avec Léa Mysius et Jacques Audiard) et qui repose avant tout sur des personnages. De vrais personnages, entiers et denses qui révolutionnent notre regard. (Je l’ai déjà écrit plusieurs fois mais Portrait de la jeune fille en feu m’a fait redécouvrir le cinéma.)
Dans ce film, comme dans Portrait, les actrices ne jouent pas avant tout des femmes, ce qui relèverait du syndrome de la schtroumpfette. Elles interprètent des personnages. Émilie (génialement interprétée par Lucie Zhang) est une jeune femme qui a des problèmes relationnels, ne sait pas comment gérer la naissance de son sentiment amoureux, se trimballe une lourde culpabilité par rapport à sa famille, etc. Elle n’est pas juste «une femme». Cette création d’un personnage complet et complexe permet d’ouvrir l’imaginaire, de créer d’autres modèles féminins plus denses, plus opaques, de présenter ces femmes comme des actrices à part entière d’une intrigue qu’elles ne subissent pas et venant de l’extérieur, mais qui naît également d’elles-mêmes. (C’est aussi vrai pour le personnage féminin interprété par Noémie Merlant.)
Or cette finesse dans les personnages, dans la manière de faire de chacun un être humain plongé dans le monde, on la retrouve avec le personnage de Camille, joué là aussi génialement par Makita Samba. Il se trouve que Makita Samba est noir. Mais dans ce film, il ne joue pas un Noir. Ou pire, le Noir, comme on le voit souvent au cinéma. À l’instar de Lucie Zhang, il est plus qu’une assignation. Ils la débordent. La finesse de l’écriture permet d’éviter tous les stéréotypes.
Ainsi, le personnage de Camille a une activité sexuelle intense –ce qui aurait pu passer pour un cliché reposant sur un stéréotype raciste qui présente souvent les personnes noires de façon hypersexualisée. Mais dès le début, la question est évacuée par le personnage lui-même qui explique son activité sexuelle par le besoin de compenser sa frustration professionnelle (il est prof de… français, bien sûr). Cette explosion des cadres crée une liberté chez les personnages et dans l’histoire, un vent de fraîcheur qui vous fait sortir de la salle avec le sourire aux lèvres. Et de nos jours, toute raison de sourire est bonne à prendre.
C’était une belle semaine. Ce texte est paru dans la newsletter hebdomadaire de Titiou Lecoq.