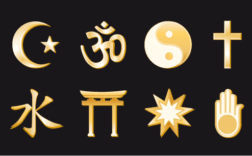En 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, une étude réalisée par l’IFOP pour Atlantico a montré que la proportion de Français estimant que la présence d’une communauté musulmane constitue une menace pour l’identité du pays n’a presque pas varié (44% contre 40%), et ce malgré les attentats de janvier. N’est-ce pas l’illustration d’une résilience de la société française après des événements comme ceux qu’on a connu ce week-end ?
Gilles Clavreul : L’un des buts théorisés par les stratèges du djihad de « troisième génération », comme le nomme Gilles Kepel, était d’entraîner les pays européens, et la France en particulier, du fait de son importante population de confession musulmane, dans un engrenage de violence. Les attentats devaient déclencher la fureur des opinions publiques et conduire à des représailles contre les musulmans, ce qui aurait permis de radicaliser les positions de part et d’autre et de légitimer, au sein de la supposée « communauté », les tenants de la ligne dure. Mais les choses ne se sont pas du tout passées comme les jihadistes l’auraient voulu. Non seulement la France a fait bloc le 11 janvier, mais les actes anti-musulmans des jours qui ont suivi – principalement des tags, des têtes de cochon déposées devant les mosquées, mais aussi quelques violences par armes à feu dont les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves – se sont étalées sur quelques semaines, avant un retour au calme. Au total, les actes anti-musulmans ont certes atteint un pic en 2015 – 429 actes -, mais l’augmentation était entièrement acquise au cours du premier trimestre. Dès 2016, les actes ont fortement baissé (185 actes) avant d’atteindre un plancher en 2018 avec seulement 100 actes sur toute l’année, soit cinq fois moins que les actes antisémites.
Ce moment crucial de l’Histoire de notre pays n’a pas encore été analysé comme il le mérite. Quoi qu’on pense du bilan politique du quinquennat précédent, il me semble que ses responsables ont été à la hauteur de la situation et qu’on peut le faire crédit, au-delà de nos sensibilités respectives, d’avoir eu de bonnes réactions, à la fois symboliques, sécuritaires, etc. Mais, incontestablement, sans que le politique y soit pour grand-chose, quelque chose s’est produit plus en profondeur dans la société française, comme si les Français, héritiers d’une histoire longue, celle de la République et des valeurs qui la portent, avaient compris la nécessité de resserrer leurs liens, de revenir aux gestes qui permettent à une communauté politique de se retrouver – se réunir, discuter, se reconnaître des responsabilités vis-à-vis du collectif – bref, d’opposer à la violence terroriste, non pas une tolérance insipide, mais un sens réinstitué du commun. Il me semble que les services publics et ceux qui y concourent de près ou d’un peu plus loin (bénévoles, associations, etc.) ont joué, dans les premières lignes de la République, un rôle essentiel à cet égard.
On ne doit cependant pas non plus enjoliver le tableau à l’excès. D’abord, l’envie d’en découdre existe aussi, dans une frange minoritaire de la population. Même si nous n’avons pas la même tradition de mouvements suprémacistes néo-nazis qu’aux Etats-Unis ou dans le nord et l’est de l’Europe, nous ne sommes pas à l’abri d’actions violentes conçues comme des « représailles blanches ». On peut aussi redouter, davantage peut-être, une bagarre qui dégénère et qui se termine par une ratonnade, dans le quart sud-est en particulier où là aussi, l’histoire longue a son poids. De l’autre côté, l’islamisme, sous ses multiples avatars, n’a pas ralenti sa progression, bien au contraire. A chaque attentat correspond une contre-offensive médiatique qui tente de renverser la responsabilité des drames qui surviennent sur l’Occident, ou la France. Dès le 11 janvier, on revendique de n’être « pas Charlie », puis on dénonce la « déferlante islamophobe » dont la marque serait moins les têtes de cochon devant les mosquées que le « racisme d’Etat », un thème appelé à faire florès après le Bataclan et le déclenchement de l’état d’urgence. En août 2016, c’est le burkini qui est monté en épingle, si on ose dire, deux semaines après l’attentat de Nice, sur les lieux mêmes où il s’était produit. A chaque fois, il s’agit d’effacer symboliquement ce qui vient de se produire et de retourner la responsabilité contre l’Etat, avec l’appui d’acteurs médiatiques, politiques et même, parfois, institutionnels, sans parler de la large caisse de résonance que lui offrent, en Angleterre et aux Etats-Unis, des médias « progressistes » peu au fait des réalités hexagonales, ou plus prosaïquement bon public quand il s’agit de faire du French bashing.
Le 11 décembre 2015, un mois après les attentats, un meeting « Pour une politique de paix, de justice et de dignité » rassemblait à Saint-Denis des organisations d’extrême-gauche, des sections syndicales, des représentants de la Ligue des Droits de l’Homme, autour des collectifs décoloniaux, du Parti des Indigènes de la République, du CCIF, des universitaires militants, etc. L’invité d’honneur est Tariq Ramadan. Entre deux motions de soutien à la Palestine, on dénonce une justice d’exception et une police raciste. On retrouvera plusieurs des orateurs, dont certains ont des liens directs plus ou moins avoués avec la mouvance des Frères musulmans, dans des réunions organisés par des institutions officielles comme la CNCDH que je citai plus haut, ou mobilisés dans des partenariats locaux pour, soi-disant, lutter contre le racisme et les préjugés, voire bénéficier de financements publics.
Au fond, l’islamisme dur, celui des attentats, n’a pas réussi la percée symbolique qu’il espérait. Mais l’islamisme soft, celui qui prétend incarner un juste milieu, œuvrer au « vivre-ensemble », être un partenaire pour les pouvoirs publics et qui dispose d’une certaine sympathie parmi des relais d’opinion « progressistes », celui-là continue de marquer des points. Or, quoique rivaux, ces deux islamismes partagent une même matrice idéologique, un même corpus de valeurs, et surtout un même horizon téléologique. Ils diffèrent par les moyens plus que par les buts. De ce point de vue, la très faible connaissance qu’ont les acteurs publics dans leur ensemble des forces agissantes au sein de ces différentes mouvances est un vrai problème, jusqu’à présent irrésolu. Chez les élus ou dans les administrations, à part quelques vrais spécialistes qui sont rares, on ne sait trop à quel imam se vouer et on mise un peu au hasard sur toutes les cases du tapis, avec une dilection pour les plus coopératifs des véhéments. Or cette recherche des « compromis acceptables » ne peut fonctionner qu’avec des acteurs sincèrement désireux de coopérer. Tel n’est pas le cas des Frères musulmans.