Le débat équitable et le sens de la nuance sont-ils encore possible au stade « twitter » de la démocratie ? Autrice d’un bel essai contre Les Conspirateurs du silence, la philosophe Marylin Maeso nous éclaire sur les racines de la violence verbale qui s’exprime aujourd’hui sur les réseaux et sur les moyens de s’en soigner. Selon elle, « nous sommes en train de développer une société du soupçon. »
interview par Sarah Sasbsibo publié sur le site ladn.eu, le 10 06 2020
On parle beaucoup de « cancel culture », cette pratique qui consiste à décréter qu’une personne qui a dit ou fait telle ou telle chose doit disparaître de la sphère médiatique. En quoi la cancel culture vous semble-t-elle particulièrement problématique ?
Marylin Maeso : La « cancel culture » fonctionne comme une sentence sans appel. Une fois « canceled », peu importe ce que la personne pourra faire ou dire, on la renverra toujours à son erreur comme à une cellule d’où elle ne doit plus jamais sortir. On bascule d’une logique du débat à une logique de mise à mort profondément déshumanisante. C’est une négation de l’imperfection constitutive de tout être humain, du fait que nous faisons tous des erreurs, que nous disons tous des choses stupides, voire scandaleuses. Et c’est aussi une manière de refuser toute possibilité de prise de conscience, de correction et de pardon. Au nom d’un idéal de pureté illusoire et mortifère, on résume un individu à un moment de sa vie.
Quelle incidence sur le débat public ?
M. M. : À partir du moment où vous voulez réduire l’autre à une chose qu’il a dite, vous vous mettez vous-même dans l’incapacité de percevoir les désaccords autrement que comme une forme d’hérésie ou d’insulte personnelle. Cette posture explique selon moi une part de la violence verbale qu’on trouve dans certains de nos débats.
Il y a une certaine soif d’absolu dans cette démarche ?
M. M. : C’était déjà l’idéal de la Terreur. Saint-Just et Robespierre partageaient ce fantasme de la transparence et de la pureté des cœurs, dans lesquels on devait pouvoir lire comme dans un livre ouvert. Nous sommes en train de développer une société du soupçon. À chaque fois que quelqu’un va dire quelque chose qui nous dérange, plutôt que de rester sur le terrain du débat contradictoire, on attaquera la personne elle-même.
Quel est le risque pour une société qui ne sait plus débattre ?
M. M. : Albert Camus disait : « Devenus ainsi aux trois quarts aveugles par la grâce de la polémique, nous ne vivons plus parmi les hommes, mais dans un monde de silhouettes. » À partir du moment où l’on ne voit plus dans l’autre un interlocuteur, mais un ennemi à abattre ou à « annuler », on ne vit plus parmi des êtres de chair, avec leurs erreurs et leurs moments de grâce, mais dans un pandémonium d’étiquettes abstraites collées de manière réflexe sur les uns et les autres : « féminazi », « facho », « islamo-gauchistes »… L’essentialisme rend le dialogue impossible.
Comment définiriez-vous l’essentialisme ?
M. M. : À l’origine du phénomène, il y a un besoin légitime de simplification du monde par le langage, en vue de le rendre plus lisible. Plus la réalité est complexe, plus nous avons besoin de généralités pour nous y repérer. Mais lorsque cet outil devient lui-même sa propre fin, lorsqu’on simplifie non plus par nécessité, mais par facilité, on tombe dans l’essentialisme, qui crée une sorte d’écran en trompe-l’œil entre nous et le réel, jusqu’à remplacer ce dernier pour lui substituer un univers manichéen, peuplé de progressistes et de fachos, où la nuance n’a pas droit de cité.
C’est ce qui aboutit à ce que vous appelez un « univers du procès » ?
M. M. : L’univers du procès consiste à faire en sorte que toute parole appelle automatiquement un jugement. Le but n’est pas tellement de comprendre de quoi on parle, mais d’abord d’être pour ou contre, et de le faire savoir. Ce goût du verdict immédiat favorise effectivement les procès expéditifs, et polarise les débats, qui virent de ce fait inéluctablement à la polémique stérile.
Le rapport à l’altérité peut-il nous réapprendre à ne plus désigner l’autre comme un ennemi mais davantage comme un adversaire ?
M. M. : Absolument. Tous ces phénomènes témoignent d’une perte du sens de l’altérité. L’altérité, c’est l’acceptation de la différence et l’acceptation du désaccord. Cela nous amène à questionner, individuellement et collectivement, notre capacité de reconnaissance de l’autre, indépendamment de son origine, de sa couleur, de sa religion, en dépit et au-delà des propos déplaisants qu’il peut tenir. Le préalable à toute vie en société réside dans notre capacité à sacraliser l’altérité.
L’individualisme de nos sociétés ne heurte-t-il pas cette nécessité de sacraliser l’altérité ?
M. M. : L’altérité, c’est aussi la possibilité pour toute personne d’être telle qu’elle est dans sa spécificité, sans qu’on la force à se fondre dans un moule. Dans le discours identitaire, l’individu peut s’identifier intégralement à une identité collective et être essentialisé comme noir, arabe, musulman, juif… C’est le contraire de l’individualisme. Que signifie la banalisation de termes tels que « collabeur » ou « beurette de service » ? C’est le prix à payer pour quiconque a l’audace de vouloir être une personne singulière dans un monde où on le pousse à être d’abord le membre d’une communauté. S’il y a un philosophe à lire ou relire pour comprendre où mène ce genre de dérives, c’est Emmanuel Levinas, dont la philosophie met en lumière le caractère fondamental de l’altérité pour notre humanité.
« À une époque de manichéisme universel, se vouer à la nuance est un acte révolutionnaire », concluez-vous dans votre ouvrage Les Conspirateurs du silence.
M. M. : La facilité se trouve du côté de l’extrémisme. Quand on est en colère, il est beaucoup plus facile de s’énerver que de prendre du recul. Albert Camus expliquait, dans L’Homme révolté, que la démesure est un confort, toujours, et une carrière, parfois. Le travail de nuance et de mesure est d’abord un travail sur soi-même, très loin de la tiédeur. S’il se refuse à mettre le feu, bien davantage, il nous éclaire.





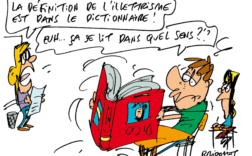



Pingback: ALORS QUOI DEMAIN ? Références (liens) de l'essai de Serge Dielens (editions-aptitudes.com, octobre 2020)