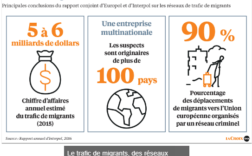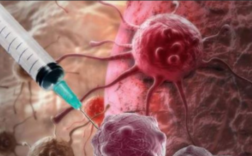Caissières, conducteurs, infirmières, ouvriers du BTP… Il y a deux ans, la France entière saluait l’abnégation de ces « premiers de corvée » restés au front. Que sont-ils devenus ? La Croix L’Hebdo est allé à leur rencontre, à l’aube, sur la ligne B du RER. Parole au peuple du petit matin.
article par Marie Boëton publié sur le site lacroix.com, le 16 02 2022
Gare RER de Sevran-Livry, un petit matin glacial de décembre. Tout autour, des façades muettes. La Seine-Saint-Denis dort encore à poings fermés. Bientôt, ce sera le grand fracas mais, pour l’heure, tout se tait. Au loin, on soupçonne le bus de nuit de 5 h 25. Le voilà. Il largue son bataillon de travailleurs. Dans cette armée des ombres encore ensommeillée, tous portent le même uniforme : bonnet, anorak, jean, panier. Point de coquetterie, du fonctionnel. Une fois à leur poste, qui les remarquera ? Comme le poinçonneur des Lilas, chanté en son temps par Gainsbourg, ce sont là, pour la plupart, des « gars qu’on croise et qu’on ne regarde pas » .
Parmi eux, Sandrine, visage sans âge et épaules lasses. Caissière dans une supérette de la gare du Nord, elle embauche à 6 h 30 mais fait une halte au Terminus, le bar-tabac face à la gare RER, pour jouer au Black Jack. Encore perdu. Il ya de l’amertume dans l’air. Ce matin, tout l’agace : son travail, « caisse, ce n’est pas pour le plaisir, ça s’est trouvé comme ça, c’est tout » ; ses clients, « toujours speed, avec les écoutes sur les oreilles » . En réalité, la France entière l’énerve : « Tous ces gens qui applaudissent les soignants, avec les casseroles et tout… Et, pour nous, rien. » Mais ce qui la mine le plus, c’est encore de devoir se lever à l’aube. À choisir, entre le manque de considération et le manque de sommeil, elle n’hésite pas :« Le pire, c’est la sonnerie de 4 h 40. Le réveil, c’est la première insulte de la journée. » D’ailleurs, la discussion finit, elle aussi, par l’agacer. À nos questions succèdent des silences de plus en plus longs et pesants, comme pour dire « laissez ma vie tranquille » .
À l’autre bout du zinc, le peuple de l’aube offre un autre visage : Andrej, un « Yougo » comme il se définit lui-même, ouvrier dans le BTP. Visage massif, boule à zéro, regard bleu-gris, jovial en diable. « C’est nous, les braves ! Faut se dire ça et on garde le moral ! » Et lui, comment vit-il ce réveil aux aurores, ces journées de douze heures et le peu de considération porté à son métier manuel ? À chaque question, la même réponse : « Moi, je dis toujours : la France, elle m’a donné ma chance ! » Ses débuts ici ont pourtant été grossiers lorsque, clandestins, il se levait en pleine nuit pour arriver parmi les premiers sur le parking du Brico Dépôt d’Ivry pour proposer ses bras aux patrons du bâtiment. Une époque révolue.« Maintenant, je suis officiel » , dit-il, bombardant le torse sous son gilet orange fluo avec, dans le dos : « Terrassement, Infrastructure, Démolition ».
« Vous vouliez voir la France qui se lève tôt ? Ben, la voilà ! » , lance la Patrouille, surnom du patron du troquet. Il se met d’ailleurs dans le lot, lui qui ouvre à 5 h 30. « Mais, attention, bosser autant… ça bouffe la tête. Mes copains, ils me disent souvent : »Toi, à force de te lever à pas d’heure, tu prends deux ans tous les ans ! » » D’un coup, tout ce petit monde se volatilise pour prendre le RER de 5 h 50, direction la capitale.
À bord du wagon, un vaste silence fatigué. Fait notable, personne ne regarde son téléphone. À cette heure-là, chaque geste est compté, on finit sa nuit. Au milieu de la rame, Ousmane. « Je me lève tôt, je travaille dur, je paie mes factures. J’affronte la vie, quoi ! » , résume le Sénégalais. Ce comptable de formation est devenu, une fois en France, agent de sécurité incendie. Affecté dans une administration de Seine-et-Marne, il gagne 1 300 € par mois, « mais ça peut monter à 1 900 € avec les heures sup » . Quitte à dépasser les 48 heures hebdomadaires autorisées. Pas très légal tout ça… « On le fait tous. La Sécurité sociale ferme les yeux. » Reste, cependant, à tenir lors de ces journées à rallonger. Un jour, Ousmane a failli s’évanouir au travail.
On l’avait affecté chez Boucheron, le célèbre joaillier de la place Vendôme, et à l’époque, il enchaînait, après sa journée sur place, avec la surveillance de nuit d’un entrepôt en banlieue. « Mais, un soir, un client est arrivé à la bijouterie deux minutes avant la fermeture. Dans ces cas-là, on doit rester ouvert le temps qu’il fait son choix. Les clients, là-bas, ce sont des princes, des Saoudiens, tout ça… Bref, à 21 h 45, j’y étais encore ! Et je n’en pouvais plus : j’avais bossé la nuit d’avant, j’étais debout depuis le matin, j’avais la tête qui tournait. J’ai cru que j’allais m’évanouir… »
« Je croise madame entre 22 et 23 heures » Ousmane, agent de sécurité
Quel endroit, dans tout ça, pour la vie de famille ? « Je croise Madame entre 22 et 23 heures, quand elle rentre de ses ménages. » Et les enfants ? Ousmane s’attarde peu sur ses trois aînés mais se félicite d’avoir envoyé son petit dernier (huit ans) dans un international au Sénégal. « Pour qu’il étudie bien. Sa mère et moi, on ne peut pas être à la sortie de l’école… » Il reviendra dans deux ou trois ans, « quand il saura bien apprendre » . Le fils d’Ousmane doit faire mentir les statistiques, corrélant fortement la réussite scolaire des élèves et le milieu social des parents (1). Le paternel avoue s’ennuyer de son gamin, « même de ses bêtises » .
Autour d’Ousmane, dans la rame, une grande majorité d’immigrés. « Normal, on prend les boulots que les Français ne veulent pas » , lance-t-il. À la fenêtre, des barres en vrac. Au loin, un dégradé de gris jusqu’à ce semi-remorque bleu ciel barré d’une flèche souriante, symbole d’Amazon. Dans les entrepôts du géant américain, basés à Aulnay-sous-Bois, c’est déjà l’effervescence.
La gare de RER de Sevran-Livry.
Rancœur et ressentiment
Le Blanc-Mesnil, Drancy, Le Bourget… Les gares défilent. Stéphane, coupe en brosse et épaules bodybuildées, monte à bord à La Courneuve. Surveillant dans une prison d’Île-de-France, son emploi du temps tient du casse-tête : 7 heures à 13 heures puis, le même jour, 19 heures à 7 heures, suivi d’une récupération d’un jour et demi avant deux jours de travail en horaire décalé. « À la fin, la semaine ressemble à rien. » Il gagne 1 500 €, rémunéré s’ajoute les heures supplémentaires de nuit et du dimanche. « En fait, pour un salaire décent, faut bosser non-stop » , soupire-t-il. Quand Stéphane a intégré la pénitentiaire, il y a deux ans et demi, on lui avait vendu un métier aux « avant-postes de la République » . Aujourd’hui, le trentenaire se voit plutôt comme« un ouvrier de la fonction publique » .
Alors il mâche et remâche son ressentiment. « Dans les médias, y en a que pour les détenus. Leurs conditions de vie, leurs tentatives de suicide, leur réinsertion à la sortie… Mais nous, les surveillants, on est où dans le tableau ? Quand est-ce que vous parlez de nos vies, à nous ? » On lui tend notre micro et il fait notre procès… Impossible, pourtant, dans ces propos ourlés de rancœur, de ne pas entendre quelques vérités salutaires.
« En fait, y’a les diplômés en télétravail. Et puis nous, les prolos, au front »
Autre motif de rancœur : le télétravail. Le surveillant, qui voit la France s’y convertir, sait qu’il ne sera pas de la partie. « Là, pour la première fois, je regrette de ne pas avoir fait d’études. » Et il ajoute, avec son parler cash : « En fait, y a les diplômés en télétravail. Et puis nous, les prolos, au front » (2). Vraiment ? Le RER B, qui dessert les aéroports de Roissy et Orly mais aussi les hôpitaux Saint-Louis, Port-Royal ou l’Hôtel-Dieu, draine sans doute aussi des pilotes et des chirurgiens prenant, comme lui, leur service aux aurores. « Des pilotes ? J’crois pas, non ! Quand j’étais ado, on en voyait dans le RER. Maintenant, ils fument des Uber. »
Stéphane, un recalé de l’espoir ? Pas sûr. « Je vais voir si je peux passer le concours des douanes. » De quoi ouvrir, un peu, l’horizon. À côté de lui, une jeune femme, en tailleur et panier, lit et annote 7 Techniques pour gagner du temps . En face d’eux, un petit homme frêle psalmodie tout bas le Coran. Des France parallèles.
Dans le wagon, toujours cet épais silence. Adieu la Seine-Saint-Denis, bienvenue dans Paris, Ville lumière… mais par voie souterraine. Après un tunnel sans fin, arrêt Gare du Nord. À peine à bord, Moktar, tempes grisonnantes et allure bonhomme, se met illico en chasse d’une place. Ce balayeur de la Ville de Paris arbore un sourire triste : « Mon travail n’a aucun intérêt. Je balaie et, juste après, c’est revente. » Pas plus de gratification du côté des piétons : « Je m’arrête souvent pour les laisser passer mais je n’ai jamais un merci, même pas un petit geste. Les collègues disent qu’à force on s’habitue. Pas moi. »
Dans une autre vie, Moktar était conducteur de véhicule pour enfants handicapés. « Les parents me remerciaient tous les jours ! » Mais, après dix-huit ans de bons et loyaux services, il est parti, las de voir son salaire plafonner à 1 300 €. En intégrant, il y a trois ans, le Service technique de la propreté de Paris, il avait un plan : entrer par la petite porte et passer, dans la foulée, un concours de catégorie B pour « travailler dans un bureau » .
C’était sans compter la fatigue. « Quand je rentre du boulot, mon corps lâche. Je n’ai plus d’énergie. » Le quadragénaire dort le reste de l’après-midi, regorge d’énergie en soirée, se couche tard… avant le réveil aux aurores. « J’ai tout faux ! » , lâche-t-il, un sourire en coin plein d’autodérision. Moktar avoue d’ailleurs avoir joué les prolongations, la veille, en regardant la finale de « Koh-Lanta ». « Mais bon, faut bien vivre… »
L’usure et la solitude
Il connaît par cœur les réactions à terme du manque de sommeil sur la santé. Mais c’est un autre problème qui le préoccupe en ce moment : « J’ai de plus en plus du mal à lever le bras gauche. L’autre jour, je n’arrive même plus à sortir les cigarettes de ma poche. » Sa crainte : qu’à force de répéter les mêmes gestes, son corps ne réponde plus.
« La société, elle a été mal faite. Il y a ceux qui triment au ras du sol, comme moi. Et, tout en haut, ceux qui profitent. » Toujours ce sourire triste aux lèvres, il ajoute : « Je suis un fatigué de la société. » Coup de blues passager ou profonde lassitude ? « Oh, ça remonte ! Gosse, j’étais déjà un fatigué de l’école. » Arrêt à Châtelet, Moktar a disparu, digne et silencieux.
Le RER reste immobilisé pour « régulation du trafic » . L’occasion de descendre pour commander un expresso au DéliCrêpes de la station. Au service, ce matin : Estelle, une étudiante en théâtre. « Je fais ça de 6 à 11, le matin. C’est tôt mais ça me permet d’aller en cours l’aprèm. » Entre les deux, elle tient grâce « à une petite sieste réparatrice le midi » . Elle voit ce travail comme un « bon plan » lui permettant de tout concilier. La jeune femme prête à sourire ; elle flotte dans son costume de serveuse et porte de traversée sa toque de chef. Gare, cependant, c’est peut-être la future Sarah Bernhardt… Elle a le regard décidé de ceux qui compétents bien imposer leur chance.
« Je voulais être solidaire du reste du pays »
Retour à bord du RER. Le train reprend son parcours : Saint-Michel, Luxembourg, Denfert-Rochereau. Entre les gares, une succession de tunnels. Pas une seule perspective sur Paris. À croire que la capitale se refuse aux banlieusards… Florence, conductrice du RER B, prend son service à Denfert. Lorsqu’elle est « du matin » , elle embauche au plus tôt à 5 h 30, et, au plus tard, à 6 h 30. « Quand on prend à cette heure-là, pas de soirées tardives, ni d’apéro après 20 heures » , confie-t-elle dans un joli rire. Entrée à 19 ans à la RATP, elle a fini par se faire à ce rythme monacal. À la maison, ça grogne un peu. « Je voudrais une maman normale ! » , traduit son adolescente de fille.
Mais Florence se sent bien aux manettes de son RER. « J’aime l’idée d’être maître à bord du train. » L’idée, aussi, d’être utile à la collectivité. D’où son choix, lors du premier confinement, de continuer à rouler alors qu’elle était éligible, en tant que maman solo, au chômage partiel : « Je voulais être solidaire du reste du pays. »
L’âge avançant, elle avoue pourtant perdre en sérénité. Les récents décès de deux collègues quinquagénaires (tous deux foudroyés par un AVC) l’ont sonnée. « À force de travailler en décalé, le corps paie le prix. » Pour l’heure, aucun pépin de santé à signaler de son côté, hormis deux disques écrasés ( « C’est la ligne 4 du métro, ça ! Quand je le conduisais, le siège du conducteur n’avait pas d’amortisseurs » ).
La grogne des voyageurs lui pèse aussi, par moments. « Le train et moi, c’est la même chose à leurs yeux. En cas de retard, ça tombe sur moi ; Je sais que je vais avoir mon lot d’insultes et de bras d’honneur. » Les incidents sont fréquents sur la ligne B, mais de nature diverse (bagage oublié, problème d’exploitation, incident grave de voyageur, défaut d’alimentation électrique…). Les torts sont partagés entre la RATP, les usagers et les pouvoirs publics, épinglés par la Cour des comptes pour leur « sous-investissement persistant » . Mais le mécontentement des usagers, Florence se le prend en pleine face. Et seule.
À l’entendre, ces tensions seraient plus rares avec les voyageurs de l’aube. « Ce sont peut-être des gens plus tolérants ? Ou alors plus résignés. » Plus aimables, c’est sûr : « Quand je vois quelqu’un courir pour prendre son train, je patiente quelques secondes à quai. Eh bien, tôt le matin, on me remercie souvent d’un petit geste. Après, en journée, c’est plus rare. Comme si c’était un dû… » Le RER remis en marche, cap sur la banlieue sud.
Gare de la Cité-universitaire, enfin l’air libre ! En levant le nez, sur devine les cimes du parc Montsouris. C’est ici que descend Latifa, la cinquantaine. Femme de ménage pour une entreprise située porte d’Orléans, elle a tout fait par le passé : « la poussière chez les mamies » , comme le nettoyage pour des marques de renom. « J’ai même travaillé chez Chanel. Enfin, au ménage, hein ! »
« Depuis la France, je n’ai plus jamais fait une vraie nuit » Latifa, femme de ménage
Habitant La Garenne-Colombes, la quinquagénaire entame son marathon avec le bus de 5 h 05 avant d’enchaîner avec les RER A et B. « Je ferais n’importe quoi pour arriver à l’heure. Lors des grèves de 2019, j’allais au travail à pied. Trois heures à l’aller, pareil au retour. » Ses horaires sont à peu près les pires qu’on peut imaginer : 6 heures-9 h 30 puis 17 h 30-21 heures. « C’est pour ne pas déranger les gens des bureaux » , dit-elle sans une fois de plainte. Les discours syndicalistes dénonçant l’aliénation de certaines conditions de travail lui restent totalement étrangers. Latifa se couche à 23 heures, se lève à 4 heures, « même pendant les vacances, je suis appliqué comme ça maintenant… De toute façon, depuis la France, je n’ai plus jamais fait une vraie nuit ».
Lorsqu’elle a quitté le Maroc en 2003, un Deug de science éco en poche, elle s’imaginait un destin de bureau. « Je me serais bien vue… » Elle s’arrête net. Sur insistance. Elle hésite. « Je serais bien vue directrice de banque » , fini-elle par lâcher. Latifa en rigole puis la rose lui monte aux joues, comme si elle avait un peu honte d’avoir rêvé si haut.
Hiérarchie et exploitation
Comment concilie-t-elle son planning impossible avec sa vie de famille ? « Je n’ai pas de responsabilités chez moi » , répond celle qui n’a ni compagnon ni enfants. Comment font ses collègues ? « Ce sont souvent des hommes qui ont laissé leur famille au pays. Beaucoup d’Africains. D’ailleurs, tôt le matin, il n’y a qu’eux dans le RER. » Et ses collègues, comment font-elles garder leurs enfants en bas âge ? « Soit leurs maris s’en chargent, soit elles les confient à des nonous. À cette heure-là… plutôt à des nonous sans papiers. » Un baby-sitting rémunéré entre 200 et 300 € par mois.
Le peuple du petit matin a, lui aussi, ses formes d’exploitation et ses hiérarchies. Les clandestins se trouvent relégués tout en bas. La quinquagénaire ne s’apitoie ni sur eux, ni sur elle, ni sur personne. « On est là pour bosser, on tient ferme. » Et qu’importe que les « gens des bureaux » ne la gratifient pas toujours d’un bonjour, elle serre fort contre elle son courage et lâche : « Je gagne ma journée. J’ai ma fierté. » Sur ces mots, Latifa disparaît.
Le RER reprend sa course, offrant une vue dégagée sur les rues pavillonnaires de Bourg-la-Reine et les habitations populaires de Montrouge. À l’horizon, des grues grignotent le ciel. La capitale devenant inabordable, on densifie la banlieue.
« Je suis arrivée il y a quatre ans, et je suis la troisième plus ancienne ! »
Dans le wagon, le téléphone portable fait, peu à peu, son apparition. Il happe les regards, un vrai doudou digital ! Adèle ne s’y perd pas. Infirmière « en réa » à Saint-Louis, elle rentre du travail, où elle vient d’aligner douze heures non-stop. La jeune femme alterne un mois de nuit (19 h 15-7 h 30) et deux mois de jour (7 h 15-19 h 30). « C’est un métier hyper intéressant. Plein de responsabilités aussi. A la vie des patients entre nos mains. »
Avec l’énergie de ses 27 ans, Adèle donne tout. Calcule tout aussi : comme lorsqu’elle est du matin et qu’elle se force à petit-déjeuner copieusement, sur les coups de 5 h 15, sachant que « vu le rythme » , la pause déjeuner se fera dix heures plus tard. Un quotidien de marathonien, on vous dit ! Mais les gratifications sont là, inestimables : « Au moins une fois par an, on a un patient star, un malade qui, contrairement à ce qu’on craignait, réussi à s’en sortir ! Ils reviennent d’ailleurs souvent nous voir après, pour nous remercier. Ces visages-là, je peux vous dire qu’on ne les oublie pas. »
Pourtant, sa décision est prise, Adèle ne reste pas en réa. En cause : ce rythme infernal. Et elle est loin d’être la seule. « Dans mon service, le 22 est et je suis la troisième plus ancienne alors que je suis arrivée il n’y a que quatre ans ! » En France, un tiers des infirmiers envisageait de changer de métier (3). Y at-elle songé elle-même ? « Non, j’aime ce métier, j’aspire juste à d’autres conditions de vie. » Adèle se verrait bien en oncologie, où l’on accueille les patients en chimiothérapie de 8 heures à 16 heures.
Dans le RER B, à la station de Gentilly.
Elle reconnaît les avancées du « Grenelle de la santé » en termes de moyens mais les nuances d’emblée en rappelant combien on partait de loin. « Au début du Covid, on se motivait tous, le matin, en disant : « Allez, on va à la guerre ! » Et puis, on arrivait à l’hôpital et on se fabriquait nos surblouses avec des sacs-poubelle. On en était là quand même… » Et côté salarial, du mieux ? » Oui oui. Avant le Grenelle, je gagnais 1 850 €. Je gagne 200 € de plus aujourd’hui. Voilà. »
Que faudrait-il pour la convaincre de rester en réa et, plus largement, pour empêcher les fermetures de lits faute de personnel ? La réponse fusible : réduire les cadences, diminuer le nombre de week-ends travaillés (un sur deux), proposer au personnel des logements abordables près des hôpitaux. « Il n’y a pas des logements vacants à Paris ? » , demande-t-elle, faussement ingénue, sachant qu’on en dénombre un peu plus de 100 000. Elle est lasse d’ajouter deux heures de trajets quotidiens à ces douze heures à l’hôpital. Face aux prix délirants de la capitale, elle vit en effet à Antony, où le prix au mètre carré est deux fois moins élevé qu’à Paris.
Autour de la jeune femme, dans la rame, certains sont lessivés par la vie. Elle, non… juste par son travail. Et c’est sans acrimonie qu’elle lance « la » question qui fâche et qui, en réalité, les résume toutes : « À un moment, faut savoir : on est indispensable ou on ne l’est pas ? » Le train arrive à Antony, terminus d’Adèle. La météo annonce un grand soleil aujourd’hui mais elle file dormir. On l’attend ce soir à l’hôpital. À 19 h 15 pétantes, et d’attaque….
Mars 2020, la France se confine. Les soignants et, avec eux, les métiers dits de « seconde ligne », apparaissent pour ce qu’ils sont : des rouages essentiels à la vie du pays. Ils étaient invisibles, on les découvre indispensables. Emmanuel Macron les remercie dans ses discours, nous appelant tous à ne pas oublier le dévouement qui a été le leur. Autre époque, autre contexte : il y a quinze ans (presque jour pour jour), Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidentielle de 2007, dit partir à la rencontre de « la France qui se lève tôt », un slogan de campagne devenu, depuis , une expression courante.
On le voit, les travailleurs modestes et les bosseurs scandent les discours politiques. Seul hic, nos gouvernants s’adressent à eux soit pour les appeler à redoubler d’efforts, soit pour les séduire électoralement. Les propos sont flatteurs, mais non dénués d’arrière-pensée. Nous avons choisi, nous, d’aller à la rencontre de ces mêmes salariés, mais sans agenda politique en tête, ni intention cachée. Commenter ? En échangeant avec eux, à l’aube, sur la ligne B du RER, traversant ensemble la Seine-Saint-Denis, la capitale et les Hauts-de-Seine. Ils ont accepté de se raconter. De dire leur corps parfois criblé de douleurs, leurs révoltes silencieuses, leurs espoirs d’ascension sociale, leur amertume d’être si peu suspecté… Chacun s’est désigné à sa façon. Avec une gouaille solaire, pour certains. Avec un parler faisant fi des convenances, pour d’autres.