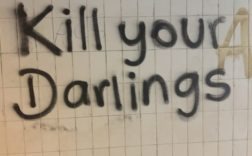Dans son ouvrage, « Repenser l’identité. Ces mensonges qui unissent » le philosophe américain Kwame Anthony Appiah ne fait pas de l’identité une borne mais un tremplin pour rejoindre l’autre.
Article par Marc-Olivier Bherer publié sur le site lemonde.fr le 16 01 2022
Enfin ! Pour la première fois, Kwame Anthony Appiah, philosophe américain, d’origine ghanéenne et anglaise, est traduit en français. Auteur à la fois érudit et d’une grande finesse, il s’intéresse depuis quarante ans à la question de l’identité, bien avant que ce thème s’impose dans le débat public.
Sa réflexion s’appuie notamment sur son expérience personnelle, celle d’homme noir, d’origine métisse, homosexuel, mais sans prôner le repli. Il vise, au contraire, à explorer les différentes façons dont nous habitons notre être, par le croisement de tout ce que nous sommes. Nulle régression identitaire ici, mais l’identité heureuse, libérale et cosmopolite.

« Repenser l’identité. Ces mensonges qui unissent », de Kwame Anthony Appiah Grasset, 416 pages, 24 euros, traduit par Nicolas Richard.
Seulement, pour y arriver, il faut éviter la « tentation organique », croire qu’un système culturel forme un tout semblable à un corps dont chaque membre aurait sa fonction propre. Adopter cette vision réductrice nous amènerait à penser, par exemple, qu’il y a une parfaite unité de l’Occident, de Platon à l’OTAN, comme si le philosophe athénien et l’Alliance atlantique n’étaient pas deux éléments distincts. Certes, il est possible de les inscrire dans une histoire commune, mais pas de les restreindre à cette lecture.
Pour vivre une identité de manière heureuse, et l’empêcher de sombrer dans la violence ou la rancœur, il faut accepter que chaque élément perçu comme la composant en soit séparable, et passible d’être revendiqué par un autre groupe. En d’autres mots, il n’y a pas d’essence fixe. De ce point de vue, il n’y a pas d’incohérence à se dire français et musulman.
Le cosmopolitisme, ou l’idée selon laquelle la culture est un bien commun à toute l’humanité, permet la circulation des pratiques culturelles, des modes de vie, des arts et des lettres, et nous affranchit d’une identité figée pour en faire un élément actif de nos vies, que nous réinventons sans cesse. Pour Kwame Anthony Appiah, l’identité n’est pas une borne, mais un tremplin pour rejoindre l »autre
Entretien
Marc-Olivier Bherer : Vous interrogez notre rapport aux identités depuis de nombreuses années, bien avant que ce thème n’occupe le débat public. Comment notre regard sur cette question a-t-il évolué ?
Kwame Anthony Appiah : Le terme d’« identité » a pris un nouveau sens après la seconde guerre mondiale. Auparavant, ce mot n’était pas employé pour désigner, comme nous le faisons aujourd’hui, le genre, la race, l’orientation sexuelle, la nationalité, la religion, etc. On ne considérait pas que ces choses pouvaient être du même ordre. Puis, avec les travaux du psychologue et psychanalyste Erik Erikson [1902-1994], on s’est aperçu que ces termes partageaient quelque chose d’essentiel en ce qu’elles nous définissent. Erikson est bien connu pour son concept de crise d’identité, qui a eu un large écho dans les années 1960 et 1970. C’est à cette époque que l’idée contemporaine d’identité émerge.
Au début de ma carrière, dans les années 1980, je me suis intéressé à la question raciale. La théorie féministe a eu un fort impact dans le développement de ma pensée. Les philosophes féministes ont établi des distinctions importantes entre le sexe et le genre, montrant que la biologie n’était pas tout, être un homme ou une femme est largement conditionné par la société. Il en est de même pour la question raciale, le corps ne peut pas rendre compte de ses dimensions sociale et psychologique.
Mais qu’est-ce au fond une identité ?
Toute identité repose sur trois choses. Elle a avant tout besoin d’être nommée, comme le philosophe Michel Foucault [1926-1984] l’a très justement remarqué. Une étiquette doit donc être mise en circulation : « français », « femme », ou « musulman », etc. Erikson a formulé ce qui constitue le second principe fondateur de toute identité : elle doit susciter l’identification, le fait par exemple de se penser comme Français. L’identité est donc quelque chose dont nous faisons l’expérience et qui marque notre vie. Le dernier élément qui fonde toute identité, c’est qu’elle détermine comment les autres vous traitent. On ne vous parle pas de la même manière si vous êtes un homme.
Défini ainsi, le terme d’identité peut être associé à beaucoup de choses, et on s’aperçoit que le phénomène qu’il tente de nommer a un fort impact sur nos vies. Si vous vous reconnaissez dans l’identité de Français, alors le devenir de la France va être important pour vous, non parce que cela affectera nécessairement votre vie, mais simplement parce que vous êtes patriote.
Que pensez-vous de l’expression « politique identitaire », généralement employée pour discréditer une cause, notamment le féminisme et l’antiracisme ?
Cette expression n’est pas nouvelle et nous rappelle qu’en un sens, toutes les identités ont une dimension politique. On ne peut pas faire plus politique que l’identité nationale. Mais l’identité religieuse peut aussi être politique. Simone de Beauvoir [1908-1986] a montré également que le genre avait une dimension politique. Il affecte ma relation à l’Etat et la façon dont l’Etat me considère. L’Etat me dit quelle toilette publique je dois utiliser.
Aujourd’hui, l’expression de « politique identitaire » est utilisée à gauche par ceux qui estiment que l’on parle trop de race et de genre au détriment de la question sociale. Mais l’appartenance à une classe sociale ou une autre est également une forme d’identité, et il est vrai que dans le monde anglophone les enjeux soulevés par ce type d’identité sont négligés. L’idée de méritocratie est responsable de cette situation, à mes yeux. Elle nous pousse à croire que ce sont les plus méritants qui réussissent. Mais c’est faux. D’une part, notre système n’est pas méritocratique, les enfants du précariat n’ont pas accès aux meilleures écoles et partent donc défavorisés. D’autre part, la méritocratie justifie les inégalités et prive ceux qui sont au bas de l’échelle sociale « des bases sociales du respect », comme l’a observé le philosophe John Rawls [1921-2002].
A droite aussi, certains estiment que race et genre occupent un espace disproportionné. De ce point de vue, le déplacement du débat occulterait non pas la question sociale, mais la nation. Sans prendre parti, je dirai simplement que l’on peut en effet accorder une trop grande attention à certaines identités au point d’en oublier les autres.
Parfois, la race ou la nation ne sont pas l’identité qu’il convient de prendre en considération pour un problème spécifique. Lorsque l’on pense au réchauffement climatique, c’est à l’échelle de son pays que l’on peut agir, mais c’est au nom de l’espèce humaine qu’il faut se mobiliser. On pourrait encore donner d’autres exemples démontrant qu’il faut trouver le bon équilibre entre différentes identités, mais il faut reconnaître qu’elles ont leur utilité plutôt que de dénoncer la politique identitaire.
Repenser l’identité, que voulez-vous dire ?
Les identités nous permettent de construire des liens essentiels avec nos concitoyens. Pour Aristote, les citoyens d’une « polis » [cité] bien ordonnée devaient se connaître les uns les autres. Mais à l’ère moderne, une telle intimité est inimaginable. Je ne peux pas connaître les 335 millions d’Américains. Un autre type de lien doit nous unir, une solidarité entre étrangers. Dans ce cadre, l’identité est incroyablement utile. C’est pourquoi les Etats ont tant investi au XIXe siècle pour construire leur identité nationale.
C’est à cette époque que la France devient ce qu’elle est. Le système d’éducation diffuse l’usage du français. L’histoire joue également un rôle important dans cette construction. C’est ce que nous rappelle Ernest Renan [1823-1892], dans « Qu’est-ce qu’une nation ? » peu importe si ce que l’on dit à propos du passé est vrai ou faux, ce qui compte, c’est que les gens y croient. Alors ils seront sensibles à l’avenir du pays. L’identité nationale peut évidemment pousser les foules au crime. Elle peut être très dangereuse. Mais un pays ne peut exister sans cet élément fondateur.
S’opposer par avance à la question identitaire en général, et pas seulement prise du point de vue national, me semble idiot. Une identité n’est pas mauvaise en soi, c’est ce que l’on fait qui compte. Et de cela, on peut débattre.
Le mot « identité » a cependant un sens très fort, renvoyant à quelque chose qui serait fixe, ne pouvant pas admettre la diversité de l’expérience humaine. Or il y a plus d’une façon d’être français…
Identité vient bien du latin « idem », ce qui signifie « même ». Mais les choses dont je viens de parler, les étiquettes, le processus d’identification et la façon dont les autres nous traitent, changent sans cesse en fonction du contexte. Tout cela est contingent. Le problème ne vient pas du terme « identité » en lui-même, s’il est bien compris. Le problème repose dans notre tendance à l’essentialisme, celle qui nous porte à croire qu’il n’y a qu’une seule manière d’être ceci ou cela.
Il y a une réévaluation constante au sein de la société du sens accordé à chaque identité. Il y a cent ans, il aurait pu sembler impossible d’être musulman et français, aujourd’hui c’est une évidence, même si certains le contestent toujours. De même, se définir comme non binaire, ni homme ni femme, aurait été considéré absurde. Aujourd’hui, plusieurs personnes se revendiquent de cette identité.
En rejetant le mot identité, on se contentera de ne pas vouloir les voir, alors qu’elles continueront d’être là. Mieux vaut reconnaître leur existence et débattre du rôle que l’on souhaite leur accorder. Ce n’est donc pas une critique du terme identité qu’il faut faire, mais de l’essentialisme. L’un des moyens d’éviter ce piège est de ne pas surinvestir l’une de nos identités au point de ne plus voir les autres. Nous devons élever nos enfants pour les aider à prendre conscience qu’ils sont plusieurs choses à la fois et qu’aucune d’entre elles n’est plus importante que les autres.
Pour arriver à cette fin, la France dispose d’un net avantage par rapport aux Etats-Unis, son attachement à l’école publique. Grâce à elle, les enfants baignent dans un milieu où les identités sont nombreuses. Trop d’Américains placent leurs enfants dans des écoles privées où il y a une claire démarcation religieuse ou raciale. Les élèves de ces écoles interagissent souvent pour la première fois sur une base régulière avec des non-Blancs à leurs 18 ans, lorsqu’ils arrivent à l’université.
Votre défense des identités vous amène à être très attaché au cosmopolitisme. Vous dites à son sujet que c’est l’universalisme plus la différence…
En effet, l’universalisme signifie que l’on se préoccupe de l’ensemble de l’humanité, que chacun compte. C’est un impératif moral que même les nationalistes ont du mal à rejeter ouvertement. Le cosmopolitisme va plus loin, le fait que l’on se préoccupe de l’autre ne va pas jusqu’à lui demander d’être comme moi, au contraire, c’est un attachement à l’autre parce qu’il est différent.
Marc-Olivier Bherer