Sur plus de 1.000 pages, des historiens ont entrepris un travail incomparable pour tout savoir sur l’esclavage, de l’Antiquité à la traite négrière. Les Mondes de l’esclavage, histoire comapéré
C’était une entreprise titanesque. Risquée. Salutaire. Étudier le phénomène de l’esclavagisme (qui n’en finit pas de revenir hanter les consciences et les débats, avec douleur et anathèmes, entre déboulonnage de statues et «devoir de mémoire») dans toutes ses dimensions. Dans toutes les civilisations et à toutes les époques où il a sévi. De la préhistoire, donc, à nos jours. Via l’Athènes du Ve siècle, la Chine des Han, l’Amérique au XVIIIe siècle, le califat de Sokoto au XIXe ou l’Ouganda contemporain. Se pencher sur le rôle des monothéismes, sur «l’ordre de la race», sur la notion de «marché» et de «propriété», sur les liens entre esclavagisme et djihad ou exploitation sexuelle, approfondir le cas d’Haïti, le problème des Lumières, parler des planteurs français comme des Iroquois ou des Vikings… Le résultat est impressionnant : Les Mondes de l’esclavage*, une somme de plus de 1.000 pages, rédigées par des dizaines d’historiens de tous les pays, sous la direction de Paulin Ismard, jeune historien célébré pour ses travaux sur la démocratie athénienne ou sur le résistant Daniel Cordier. «L’ambition de notre livre est en effet de proposer une histoire mondiale du fait esclavagiste, bien au-delà du monde colonial issu de la conquête européenne des Amériques et de la traite transatlantique», confie-t-il au sujet de cette histoire de l’esclavage à l’échelle du monde qui se trouve être aussi, de fait, une histoire du monde à la lumière de l’esclavage.
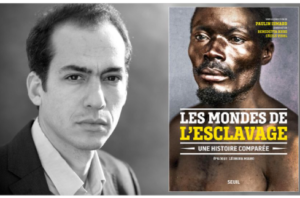
Paul Lisnard, coordinateur du livre « les Mondes de l’esclavage, histoire comparée »
Le Point : Vous avez entrepris une tâche qui semble relever de l’impossible. Quoi de commun en effet entre les formes d’esclavage de la Grèce antique, des royaumes vikings ou africains, de l’Alsace du Nord au IXe siècle ou de l’Inde contemporaine ? La question de la définition de l’esclavage sous sa forme la plus universelle est centrale. Comment reconnaître l’esclavage par-delà la diversité des termes utilisés et des situations historiques ?
Paulin Ismard : Il existe deux types de définition de l’esclavage selon qu’on insiste sur le droit de propriété qu’exerce un individu sur un autre, réduit à l’état de bien meuble, ou qu’on mette en avant le déshonneur et la «mort sociale» subis par l’esclave, exclu des cadres fondamentaux de la société (structures de parenté, vie religieuse…). Ces deux définitions ne sont pas nécessairement contradictoires. Qu’elle se fonde sur la propriété ou qu’elle découle de sa désocialisation, la mise au ban de l’esclave des formes dominantes de la vie sociale est un élément constitutif qui distingue l’esclavage des autres statuts de dépendance. Il existe des formes d’esclavage tout à fait différentes d’une société à l’autre, selon que les esclaves sont plus ou moins intégrés à la vie sociale, que l’esclavage soit d’origine interne ou externe, qu’il se légitime par le droit de la guerre ou par un discours fondé sur la race. Notre travail comparatiste vise à éclairer ces différences et non pas à définir des lois universelles propres à l’esclavage. Mais cette diversité n’empêche pas que l’esclavage soit effectivement commun à un nombre immense de sociétés.
Le Point : Le grand historien de l’Antiquité Moses Finley avait établi en 1968 une distinction entre «sociétés à esclaves» et «sociétés esclavagistes», dont l’existence était conditionnée à l’esclavage et qui se limitaient à cinq espaces historiques et géographiques (Grèce et Rome antiques, Antilles, Brésil et Amérique du Nord avant la guerre de Sécession). Est-elle encore valide ? On voit dans votre livre que la Corée du XVIIIe siècle semble présenter des traits qui leur sont comparables.
Paulin Ismard : Cette distinction est encore valide. La notion demeure précieuse pour caractériser la spécificité de certaines sociétés – celles qui ne peuvent se reproduire sans recourir à l’esclavage, et, pour certaines d’entre elles, dans lesquelles l’institution esclavagiste imprègne l’ensemble de la vie sociale. A contrario, de nombreuses sociétés ont pratiqué l’esclavage sans que l’institution esclavagiste soit indispensable à leur fonctionnement. Il reste que la définition de Finley mérite d’être amendée sur certains points et que son inventaire des sociétés esclavagistes est caduc. Finley entendait moins définir une catégorie analytique que pointer la singularité de deux configurations historiques, qu’il envisageait en miroir l’une de l’autre, celle de l’Antiquité méditerranéenne, d’une part, celle des sociétés américaines filles de l’impérialisme européen, d’autre part. Or la notion de société esclavagiste peut s’appliquer à d’autres sociétés. Vous mentionnez la Corée de l’époque Choson ; on pourrait ajouter le califat abbasside au IXe siècle, l’Empire ashanti et le royaume du Dahomey, le califat de Sokoto, la colonie du Cap jusqu’en 1834 ou la société ottomane des XVIe et XVIIe siècles.
«L’institution esclavagiste a surtout imprimé de sa marque l’ensemble de la civilisation athénienne.»
Le Point : Peut-on dire que la démocratie athénienne n’aurait pu exister sans esclavagisme ?
Paulin Ismard : Elle aurait été en effet impensable sans le développement, dans des proportions inconnues, de l’esclavage – les auteurs anciens en avaient d’ailleurs conscience. Moses Finley parlait de la «marche main dans la main de l’esclavage et de la liberté» dans le monde grec. L’Athènes de l’époque classique peut sans l’ombre d’un doute être qualifiée de société esclavagiste. Cela ne tient pas seulement au rôle indispensable du travail des esclaves dans le fonctionnement de l’économie civique, ni même à leur poids démographique, considérable. L’institution esclavagiste a surtout imprimé de sa marque l’ensemble de la civilisation athénienne. Ce constat complexifie des représentations trop naïves du fameux miracle grec, mais l’Histoire ne vaudrait pas deux heures de peine si elle consistait à faire la liste de nos admirations et de nos scandales. Et cela ne change rien à la façon dont l’héritage de l’Athènes classique – la démocratie, la philosophie, entre autres… – peut continuer à nous intéresser, ici et maintenant.
«La notion de race n’existe pas dans la Grèce antique.»
Le Point : Vous semblez indiquer que la traite et l’esclavage atlantiques, donc occidentaux, présentent des traits singuliers, notamment l’idée de race. Il n’y avait donc pas de «racisme» dans les principes esclavagistes de l’Orient, de la Grèce antique et de l’Afrique ?
Paulin Ismard : La question ne tient pas à l’existence du racisme – le terme n’a d’ailleurs pas grand sens si on l’emploie comme un invariant historique – mais à l’existence de la race comme mode de légitimation de la réduction en esclavage et comme principe d’organisation des sociétés esclavagistes. À cet égard, il y a bien une singularité de l’histoire européenne de l’âge moderne, lorsque, dans le contexte spécifique de la traite transatlantique, la race en vient progressivement à supplanter le principe du droit du vainqueur pour justifier la mise en esclavage. Ce processus complexe est mis en lumière par Cécile Vidal dans notre livre. Vous évoquez la Grèce antique : la notion de race, dans le sens qu’elle a acquis dans notre modernité, n’existe pas – ce qui ne veut pas dire que les préjugés infériorisants à l’égard de tel ou tel peuple n’existent pas, mais ils ne prennent pas la forme d’un discours qui hiérarchiserait les peuples en fonction de différences prétendument raciales, et cela ne conduit jamais à justifier la mise en esclavage, les Grecs pouvant être esclaves d’autres Grecs. La notion d’Aristote d’esclavage par nature, dont la postérité fut immense, ne justifie pas la réduction en esclavage de certains peuples parce que prétendument inférieurs.
Le Point : L’Afrique se situe «au cœur de ce vaste récit discontinu» de l’esclavage. Quelles en sont les particularités ?
Paulin Ismard : L’histoire des sociétés africaines est envisagée dans la très longue durée, depuis les premiers temps de la traite arabe dans l’espace sahélien jusqu’aux combats politiques en faveur de l’abolition dans la Mauritanie contemporaine. C’est le continent qui a payé le tribut le plus lourd à l’esclavage, ses structures sociales et démographiques étant profondément transformées par l’expérience de la traite atlantique et orientale. Il s’agit de s’intéresser à l’expérience pluriséculaire des traites, mais aussi à la façon dont celles-ci se sont inscrites ou ont transformé des structures de dépendance traditionnelle, relevant parfois de formes d’esclavage interne. Que le regard se porte sur le califat de Sokoto, au XIXe siècle, sur les royaumes ovimbundus, le Congo de Léopold ou les plantations de caoutchouc de Firestone, au Liberia, l’histoire des esclavages en Afrique est ici envisagée du point de vue des sociétés africaines, soumises pendant plus de six siècles à des transformations violentes, dont elles furent à la fois les victimes et les agents.
«Les trois monothéismes ont intégré l’esclavage à leurs textes sacrés et à leurs pratiques.»
le Point : Quel fut le rapport des grandes religions monothéistes à l’esclavage ? Dans le sultanat de Sokoto créé par des djihadistes dans le Sahel, au milieu du XIXe siècle, la moitié de la population était des esclaves. Et avec Daech, l’esclavage a aussi fait sa réapparition, notamment avec le cas des Yézidis.
Paulin Ismard : Le christianisme et l’islam se sont développés dans des contextes historiques où l’esclavage était très répandu. Ces deux monothéismes, comme avant eux le judaïsme, ont intégré l’esclavage à leurs textes sacrés et à leurs pratiques. Ils ont d’ailleurs développé ce que l’on pourrait appeler une théologie de l’esclavage, dans laquelle le Dieu unique et transcendant se comporte envers sa création, et en particulier l’humanité, comme le ferait un maître envers ses esclaves, ainsi que le montre Noël Lenski. Dans le Coran, Mahomet est désigné comme «l’esclave d’Allah», et Allah appelle ses croyants «mes esclaves». Il faut d’abord reconnaître que les deux derniers monothéismes ont légitimé et largement soutenu l’institution esclavagiste au fil de l’Histoire. Ce n’est qu’en 1839 que l’Église catholique, avec le pape Grégoire XVI, condamna officiellement la traite, considérant que ceux qui la pratiquaient étaient indignes du nom de chrétiens ! Tout en soutenant l’esclavage, ces deux monothéismes ont néanmoins infléchi plusieurs de ses traits fondamentaux. À la fin de l’Antiquité, la valorisation par l’Église des familles esclaves et la reconnaissance des parentés serviles représentent une transformation importante. Les textes sacrés musulmans régulent assez précisément les abus des maîtres et valorisent l’usage de l’affranchissement, qui permet la rémission des péchés du maître. Par ailleurs, le fait que le christianisme et l’islam aient conçu leur communauté de croyants comme un cercle fermé doté de privilèges religieux les a conduits à protéger leur population contre l’esclavage, faisant, en retour, des territoires contrôlés par les États qui se réclamaient du monothéisme adverse les zones de captation d’esclaves. Il faut par ailleurs insister sur la façon dont les Églises chrétiennes et l’islam ont été des lieux de formation de la pensée abolitionniste – qu’on songe par exemple, en Amérique du Nord, au rôle des Églises protestantes, parmi lesquelles les Églises noires jouèrent un rôle important au cours du XIXe siècle. La distinction entre catholicisme et protestantisme quant au rapport à l’esclavage est d’ailleurs au cœur de l’article de Charlotte Castelnau-L’Estoile.
Le Point : Vous semblez mettre en évidence une certaine ambivalence des Lumières sur l’esclavage. Montesquieu dénonce pourtant clairement l’esclavage dans les «Lettres persanes» dès 1721, et Voltaire dans l’épisode du «nègre de Surinam» dans «Candide».
Paulin Ismard : Il y a une ambivalence, comme le montre Silvia Sebastiani. On ne peut pas seulement les présenter comme des promoteurs du «commerce infâme», en cherchant à tout prix à dénoncer le caractère mensonger de leur prétendu universalisme. Peu d’entre eux sont des abolitionnistes actifs, mais la plupart s’opposent, pour des raisons très variées, à la traite. Il est vrai néanmoins que certains marchands d’esclaves et certains planteurs ont pu se réclamer des Lumières, en recherchant chez Hume ou chez Voltaire des passages justifiant leur pratique, et que la plupart des pères fondateurs des États-Unis d’Amérique pouvaient posséder des esclaves tout en employant le langage des droits universels de l’homme. La position des philosophes est bien plus complexe, mais il faut attendre les années qui précèdent la Révolution pour que l’idée d’une disparition définitive de l’esclavage, clairement identifié à une pratique criminelle, prenne forme, en particulier sous la plume de Condorcet et avec la Société des amis des Noirs.
Le point : Nous avons assisté aux États-Unis, mais aussi en France, à des appels au déboulonnage de statues de figures historiques liées à l’esclavage, jusqu’à celle de Victor Schœlcher en Martinique, qui a pourtant porté le décret abolissant l’esclavage en 1848. Comment l’historien voit-il ces injonctions à «corriger l’Histoire» qui semblent se limiter au procès de l’Occident – lequel n’a pourtant pas le monopole de l’esclavagisme, comme le montre votre ouvrage ?
Paulin Ismard : Je ne vois pas d’injonction à «corriger l’Histoire». J’y vois plutôt le désir, en France, de faire entrer au sein de l’histoire commune – celle de la République, ou de la nation – l’histoire de l’esclavage, qui éclaire le passé d’une partie de nos concitoyens et a longtemps été tenue pour un passé subalterne au regard des grands événements du récit européen. Or cette prise de conscience est salutaire : loin d’entraver la recherche, elle a permis d’approfondir notre connaissance du passé. Je ne vois vraiment pas où il y aurait eu l’idée de corriger l’Histoire – sauf si on entend par là le fait de réviser ce qu’on croyait savoir, mais c’est là le propre de tout rapport authentiquement historien au passé. Concernant les mouvements que vous évoquez, je crois qu’il s’agissait moins en réalité de célébrer les héros locaux de l’abolition que de placer au centre de la commémoration les esclaves eux-mêmes, en rappelant la façon dont ils ont aussi contribué à l’abolition. Il est par ailleurs possible, et même souhaitable, d’avoir un regard critique sur l’abolitionnisme du XIXe siècle. Car on peut admirer la personne de Victor Schœlcher tout en discutant la façon dont l’abolition s’est déroulée – c’est toute la question des compensations accordées aux propriétaires d’esclaves et du maintien des hiérarchies héritées du passé esclavagiste. On ne peut non plus ignorer la façon dont cet abolitionnisme a servi à légitimer le discours civilisateur de l’Europe à la fin du XIXe siècle, la conquête du continent africain se justifiant bien souvent par la nécessité d’abolir les formes d’esclavage internes au continent. Et, comme le montre Benedetta Rossi, l’Europe et l’Amérique du Nord n’ont pas le monopole de la pensée abolitionniste. Deux ans avant Victor Schœlcher, en 1846, la Tunisie ottomane et le Liberia indépendant avaient aboli l’esclavage…◾️
Illustration : Sous la direction de Paulin Ismard : «Les Mondes de l’esclavage. Une histoire comparée.»* ; coordination : Benedetta Rossi et Cécile Vidal ; épilogue : Léonora Miano – éditions Seuil, 1.168 p., 29,90 €.









