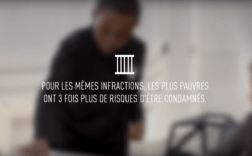L’écrivaine Kaoutar Harchi est l’invitée du Gros Journal aujourd’hui. Auteure et chercheure en sociologie, elle révèle les travers de notre société en questionnant le modèle social français par le prisme de la littérature. Une première.
Le Gros Journal avec Kaoutar Harchi, l… par legrosjournal
Kaoutar Harchi a publié en septembre dernier un essai intitulé Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne. Des écrivains à l’épreuve, dans lequel elle s’interroge sur la reconnaissance de l’institution littéraire parisienne à l’égard des écrivains étrangers francophones. “Suffit-il d’écrire dans la langue de Molière pour être reconnu comme un écrivain français ?” peut-on lire sur la quatrième de couverture de l’ouvrage.
Mouloud Achour : Est-ce que tu pourrais te présenter ?
Kaoutar Harchi : Je m’appelle Kaoutar, j’écris des livres. Le dernier est un essai. C’est mon premier essai. Jusqu’à présent, j’avais principalement travaillé sur des romans. C’est un essai qui évoque la problématique, de la reconnaissance et plus spécialement de la reconnaissance littéraire.
Au quotidien, tu es prof rattachée à Sciences-Po. Qu’est-ce que tu enseignes, et à qui ?
J’enseigne la sociologie, et j’ai un public de jeunes gens hyper attachants.
On dit souvent que les gens qui sont à Sciences-Po sont les futures élites. Qu’est-ce que tu sens comme volonté, comme flamme, qui les habite ?
Ils ont des cadres réels de compréhension, de ce qui est en train de se passer autour d’eux. Très souvent pendant le cours – c’est assez significatif – il se forme des digressions. On peut parler de quelque chose de très précis et très rapidement être rattrapés par l’actualité, des problématiques de domination sociale, de déterminisme, d’autonomie, etc. Et je les sens toujours très investis par ces questions-là. Surtout qu’à Sciences-Po, on a la particularité d’observer à la fois des gens qui sont plutôt des héritiers, et une population nouvelle qui est en train de se former de plus en plus, qui est plutôt une classe originaire des milieux plus populaires.
J’ai découvert l’existence de Sciences-Po quand j’ai embauché un stagiaire de Sciences-Po. Je ne savais même pas que ça existait. On ne m’a pas dit « un jour, tu pourras faire Sciences-Po ». Ce n’était même pas une possibilité. Mais comment on n’est pas au courant, quand on grandit dans un quartier, que ces choses-là existent, qu’il y a d’autres filières ? Pourquoi ?
Parce que je pense que ça repose fortement sur les logiques d’information. Qui est informé, qui n’est pas informé, où est l’information, qui la donne, qui la révèle. Et c’est certain que, dans des collèges ou des lycées que l’on dit “en difficulté”, ce sont des informations qui circulent très peu et qui n’ont pas à vocation à circuler dans ces espaces-là. C’est là où toute la problématique de l’inégalité sociale et de la manière dont l’école reproduit ces inégalités, se pose avec beaucoup de violence.
Une des thématiques que tu abordes, c’est le langage et la volonté de redonner de la précision et du sens au mot. C’est quelque chose de très fort chez toi. Il y a un mot qui t’a révolté, c’est la “bien-pensance”. Maintenant, beaucoup de gens se disent : “oui je suis bien-pensant, je m’en défends, parce que je suis de gauche.” Mais souvent, cette gauche reproduit les mêmes archétypes racistes que la droite ou l’extrême-droite. Comment cela s’exprime ?
Même d’un point de vue historique, la gauche porte une sorte de sentiment de culpabilité terrible à l’égard d’une certaine frange de la population française. Et ils sont dans des jeux d’ambivalence qui font que, très souvent, leurs valeurs et leurs croyances sont sacrifiées sur l’autel d’une forme de paternalisme, de maternalisme, qui sont souvent des plus insupportables.
Il y a un terme qu’on entend parfois qui m’énerve au plus haut point – et quand je dis « vous ne comprenez pas que c’est énervant”, personne ne comprend… C’est le mot “beurette.” C’est quoi ce mot ?
Ce mot, c’est un mot qui est très ancré pour moi dans l’univers de la pornographie. Et c’est intéressant parce que, pendant très longtemps, je crois que le corps de la femme musulmane – ou de la femme arabe – a été lié à des formes de domination sexuelle et de volonté de performance. Il y a quelque chose de très colonial dans cette histoire-là.
Il y a une nouvelle génération qui est en train d’arriver, et qui va vraiment bousculer tout ça. A la fois de jeunes femmes, de jeunes garçons, qui ont été socialisés autrement, qui ont été politisés autrement, qui n’ont pas le rapport à la télévision que nous, par exemple, avons pu avoir. Qui, dans leur esprit, sont peut-être un peu plus libres ou, en tout cas, qui ont la possibilité d’aller puiser l’information au sein de sources contradictoires. Et qui par ailleurs, ont fait suffisamment d’études pour pouvoir être très critiques et utiliser tout leur potentiel d’éducation et d’instruction pour s’affirmer et pour inventer de nouveaux modèles.
Arnold et Willy 1.1 Papa nous volià par xenahalliwell
J’ai grandi dans une espèce d’utopie à la “Arnold et Willy”. Et les nouvelles générations sont de plus en plus questionnées, et sensibles à la question identitaire. Ils sont de plus en plus divisés.
Il y a des formes de divisions. Mais disons que la volonté que ça change véritablement, que la vapeur soit inversée, est un mouvement très profond.
Il y a un point commun entre le rap et le livre que tu sors. C’est que les rappeurs écrivent. Et on met du temps avant de leur reconnaître l’acte d’écriture.
Ça, c’est très flagrant. Il suffirait de reprendre un certain nombre d’études qui ont été faites. Ce que l’on voit très clairement, c’est que l’écriture est plutôt du côté des territoires privilégiés. Et du côté des territoires populaires, on est plutôt dans des formes de revendications d’une oralité. Du côté des quartiers populaires, on aurait plutôt des slameurs, on aurait plutôt des jeunes garçons faits pour des battles, faire pour avoir de la tchatche… Et c’est une répartition qui peut a priori sembler anodine. D’un côté l’oralité, d’un autre côté l’écriture. Mais en fait, c’est quelque chose de très pernicieux. Et c’est quelque chose qui participe véritablement à un déni de reconnaissance, du fait que dans les quartiers, on écrit beaucoup.
Aujourd’hui, la nouvelle variété ne s’appelle pas Patrick Bruel, elle s’appelle Maître Gims. Pourquoi il y a toujours une volonté de le classer dans le rap, alors qu’il ne fait pas du rap ?
Il ne fait pas du rap, mais en même temps, c’est de là d’où il vient. Encore une fois, le fait de maintenir quelqu’un dans son domaine premier d’apparition fait que cela permet simplement de le catégoriser. Dans l’industrie de la musique, ça lui donne une place. Le rap devient audible à partir du moment où c’est de la variété. Donc en fait, le rap devient audible quand ce n’est plus du rap…
Aujourd’hui, on a l’impression que le discours principal du rap, c’est “je veux de la thune”.
Il y a une pauvreté, il y a une misère. Et pendant certains temps, le rap a été pour certains, une manière de s’en sortir, de produire, d’exister, de gagner de l’argent, de signer des premiers contrats. Et c’est quelque chose qui compte vraiment.
Quelles sont les punchlines qui t’ont le plus marquée ?
Booba, évidemment. J’étais très jeune, et quand je l’ai entendu dire : “Si tu veux du taf pétasse, t’as qu’à être blonde.” Ça m’a tellement marquée… Parce que je n’étais pas blonde. Et je me suis beaucoup interrogée sur cette question. En tant que fille, j’ai trouvé cela étrange, mais aussi parce que c’était tout nouveau.