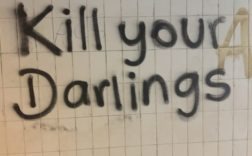Kim Phuc fut longtemps « la petite fille au napalm », ce cliché emblématique de la guerre. Au-delà des souffrances physiques, elle dut supporter d’être sans cesse réduite à ce statut de victime. Avant de gagner le Canada et de trouver une forme de bonheur.
reportage par Annick Cojean publié sur le site lemonde.fr, le 27 08 2022
Comme elle l’a détestée, cette photo ! Et comme elle en a voulu au photographe de l’avoir saisie, le 8 juin 1972, dans ce moment de souffrance et de vulnérabilité absolues, cet instant où, petite fille de 9 ans prise dans la guerre du Vietnam, elle fuit un bombardement de napalm, nue puisque ses vêtements ont été réduits en cendres, le dos, les jambes, les bras ravagés par un feu à 3 000 °C ! Comment était-ce possible, se disait-elle, que des journaux du monde entier aient osé publier l’image d’une enfant hurlant de douleur et d’effroi, risquant de mourir brûlée vive ? Et pourquoi, parmi des milliers de clichés illustrant la guerre, les livres d’histoire avaient-ils retenu cette photo-là, qui la figeait pour toujours en victime ? Longtemps, très longtemps, Kim Phuc a éprouvé de la colère, de l’amertume, et même, « oui, tu peux l’écrire, du désespoir ».
« J’ai voulu mourir à cause de cette photo », nous confie-t-elle, cinquante ans après ce bombardement, assise devant le cliché iconique exposé à Milan, dans le cadre d’une exposition consacrée à son auteur, le photographe Nick Ut, qui n’avait que 21 ans en 1972. « Je ne supportais plus d’être “la petite fille au napalm”. Elle me volait ma vie, elle m’enfermait dans le drame, je n’étais plus que cela : “la victime idéale”, instrumentalisée par le gouvernement communiste de Hanoï pour servir sa propagande. Cette photo fut longtemps ma prison… »
C’est en rentrant dans son village de Trang Bang, après quatorze mois d’hospitalisation à Saïgon, seize greffes de peau et des soins qui l’avaient fait souvent s’évanouir de douleur, que Kim Phuc l’a vue pour la première fois. Le photographe, qui avait été récompensé d’un prix Pulitzer, en avait offert un tirage à son père, et la petite l’examina d’abord avec embarras, puis avec horreur. Ensuite, elle l’oublia. Elle avait bien d’autres problèmes.
Elle souffrait le martyre
Sa famille, autrefois prospère, avait tout perdu au cours de la guerre. Ses parents déployaient mille astuces pour faire vivre leurs huit enfants, mais n’avaient guère d’argent pour acheter des antidouleurs ou les crèmes qui auraient pu soulager la petite fille. Et Kim souffrait le martyre. Elle bougeait avec difficulté ; ses mains, déformées, avaient du mal à saisir un objet, ses douleurs étaient lancinantes. Le seul moyen de trouver un répit était de marteler sa chair pour stimuler la circulation sanguine, elle demandait à ses frères et sœurs de la frapper de leurs deux mains.
Toute la famille était d’ailleurs mise à contribution pour l’aider à faire des exercices pouvant lui redonner force et souplesse : faire pivoter sa tête tout en maintenant son torse immobile, faire travailler ses doigts pour les empêcher de se recroqueviller. Chacun veillait à l’empêcher de se gratter jusqu’au sang pour calmer ses démangeaisons, courait acheter de la glace pour la poser sur son dos ou sa nuque lorsqu’elle avait trop chaud, car sa peau, incapable de transpirer, était souvent bouillante. Mais ils se sentaient impuissants face à ses maux de tête récurrents et aux accès de douleur qui lui faisaient pousser des cris.
Elle avait honte de sa peau, cachait ses cicatrices, voyait avec tristesse ses amies se détourner d’elle. Au moins s’accrochait-elle à son rêve : devenir médecin. C’était une sacrée ambition pour une enfant d’origine paysanne. Mais Kim devait la vie aux praticiens de l’hôpital Cho Ray. A son tour, elle voulait donc soigner. Alors elle se mit en tête d’être la meilleure en classe, prit des cours avec sa sœur institutrice pour rattraper les mois perdus, et étudia deux fois plus que ses camarades. En 1981, le lycée terminé, elle s’inscrivit en classe préparatoire pour entrer en fac de médecine. C’est alors que la photo est réapparue.
Un journaliste du magazine allemand Stern n’ayant jamais oublié la petite fille au napalm a écrit au gouvernement vietnamien pour avoir de ses nouvelles. Celui-ci a aussitôt diligenté le ministère de l’information : « Trouvez-la ! » Et quatre hommes ont surgi un jour à l’école de Kim, se présentant comme des fonctionnaires envoyés par le gouvernement d’Hanoï. « Es-tu Kim Phuc, la fille de la photo ? » Elle a soulevé sa manche pour montrer son bras droit et le triomphe s’est lu dans leur regard : « Elle n’est pas morte ! Ils vont être contents à Hanoï ! »
Vidéo : Pourquoi « la petite fille au Napalm » n’a pas mis fin à la guerre du Vietnam – Flashback
Cela faisait des mois qu’ils la recherchaient, remuant ciel et terre dans la province de Tay Ninh, diffusant son nom par haut-parleurs à travers les villages. Kim fut amenée dans un hôtel de Ho Chi Minh-Ville où étaient réunis un groupe de reporters, photographes et cameramen. On la pressa de questions : « Comment allez-vous ? » « Que ressentez-vous ? » « Est-ce que vous détestez les Américains pour ce qu’ils vous ont fait ? » Elle répondit le plus sincèrement possible, précisant que les bombes responsables de ses blessures avaient été larguées par des Sud-Vietnamiens et non par des Américains. Elle comprit rapidement que l’interprète du gouvernement racontait une tout autre histoire…
Séances d’interviews de propagande
Les séances d’interviews avec la presse se sont multipliées au cours de l’automne, alors qu’elle commençait ses études de médecine. Deux fois par semaine, des gardes du corps venaient la chercher sur le campus universitaire et l’emmenaient à Tay Ninh, dans les bureaux du Comité du peuple, où des journalistes occidentaux lui posaient leurs questions.
Après quoi, elle avait droit à une séance de critiques : « Ne dis pas ça aux étrangers ! Insiste sur ceci. Ne prononce pas tel mot. » Elle protestait, suppliait qu’on la laisse étudier, mais on lui répondait : « Tu es trop importante maintenant. Ton gouvernement a besoin de toi. » Et on menaçait d’arrêter ses parents si elle montrait de la mauvaise volonté. Elle était piégée. « Mais pourquoi cette photo intéresse-t-elle tant de monde ? », continuait-elle de se demander. Harassée, dormant fréquemment sur le canapé d’un bureau en attendant l’heure des interviews, elle tentait vaillamment de rattraper ses absences à la fac. Jusqu’à ce que le doyen lui annonce qu’elle était renvoyée. C’est là qu’elle a pensé au suicide.
Et puis voilà qu’un jour, cachée dans une bibliothèque, elle s’est plongée dans le Nouveau Testament. Le caodaïsme, un syncrétisme des plus vieilles religions qui conduit à vénérer de nombreux guides spirituels, était le culte suivi par sa famille. Mais ce jour-là, elle découvrit le parcours de Jésus, « ce messager de Dieu qui avait tant souffert », avait été frappé, injurié, torturé, et portait lui aussi des cicatrices. Elle se dit que lui seul pouvait l’aider à trouver un sens à ses propres souffrances, et elle se convertit au christianisme. Au moins se sentait-elle aimée par ce Dieu de compassion.
En 1983, le dixième anniversaire des accords de Paris, qui avaient mis fin à la guerre, a accru l’intérêt pour la petite fille au napalm. Les journalistes accoururent au Vietnam, Kim fut sans cesse sollicitée. En 1985, on la contraignit à se rendre à Moscou, « invitée d’honneur » du festival de la jeunesse organisé par le Komsomol et inauguré par Gorbatchev. Elle s’est retrouvée dans la capitale soviétique avec des délégués de plus de cent pays, conviée à prendre la parole en public, dans des écoles, des théâtres, puis trimballée dans tout le territoire, exhibée dans des émissions de radio et de télévision, obligée de raconter mille fois son histoire. « Une mascarade », se disait-elle, effarée d’être devenue une marionnette. A son retour, quand elle eut l’occasion de rencontrer le premier ministre du Vietnam, Pham Van Dong, et qu’elle vit dans son regard une sorte de bienveillance, elle le supplia de lui accorder un répit pour finir ses études. Il l’envoya à Cuba.
Quelle étrange idée ! Le climat et les conditions misérables de vie étaient néfastes à la santé de Kim. Elle fit de nombreux séjours à l’hôpital où on lui découvrit, en plus de l’asthme, de ses migraines et multiples allergies, du diabète. Elle comprit surtout qu’elle y était encore plus surveillée qu’au Vietnam. Pas un mouvement qui échappait à l’ambassade. Une chance pourtant, au cours des six années passées dans l’île. Une chance qu’elle attribua à Dieu : la rencontre d’un jeune homme, Toan, tombé fou amoureux d’elle.
Le mariage eut lieu à La Havane en 1992. La lune de miel ne pouvant se passer que dans un pays communiste, ce serait Moscou. C’est là qu’entre deux balades sur la place Rouge, Kim mûrit sa décision. Elle ne rentrerait pas à Cuba. Elle fuirait ce régime. Elle fuirait la photo, ce statut de « trésor national » qui la ligotait depuis deux décennies. Elle irait dans un pays où elle pourrait se créer une vie sans passé, sans image, sans instrumentalisation de ses souffrances. L’avion de retour vers Cuba devait faire une courte escale à Gander, sur l’île de Terre-Neuve, au Canada, pour faire le plein de carburant. C’était le moment ou jamais.
« Moi, je choisis la liberté »
Toan ne fut mis dans la confidence que dans l’avion. « Tu as le choix, lui dit-elle. Je ne veux rien t’imposer. Moi, je choisis la liberté. » Elle crut qu’il allait s’évanouir sur son siège. « Mais au fond de mon cœur, assure-t-elle, j’étais sûre qu’il ne me quitterait pas. »
L’avion s’est posé. Ils ont tout laissé dans l’appareil, sauf le sac à main de Kim, munie de leurs deux passeports. Et le cœur battant, ils ont rejoint derrière une porte vitrée la file des aspirants au statut de réfugiés. Ils n’avaient pas d’argent, pas de vêtements, pas d’adresse. Ils ne connaissaient même pas la carte du Canada. Mais ils étaient anonymes et enfin libres. Du moins l’espéraient-ils.
Et puis, la photo a ressurgi. Des journalistes ont débusqué l’appartement de Kim et Toan dans le quartier de Chinatown, à Toronto. La petite fille au napalm s’est retrouvée, en 1995, à la « une » du Toronto Sun. D’autres journaux allaient forcément suivre. Alors Kim, désormais jeune maman, a décidé qu’elle ne fuirait plus jamais la photo. Qu’elle l’assumerait, sans peur, sans colère, sans honte. Et qu’elle la légenderait. Oui, c’était à elle, « survivante » et non plus « victime », de lui donner un sens. Cela changeait tout. L’image illustrait l’épouvante de la guerre ? « Je deviendrais une ambassadrice de la paix ». Elle montrait la barbarie ? « Je parlerais d’amour et incarnerais le pardon. » Elle évoquait la mort ? « Je montrerais la vie ! Elle ne m’a guère épargnée, mais c’est elle qui triomphe. »
Elle se cale sur le canapé de la galerie milanaise qui l’accueille, en ce mois de mai, comme une star. Et elle sourit. Kim Phuc sourit toujours. De ce sourire radieux, plein d’amour, qui réchauffe et apaise ses interlocuteurs. « Ne crois pas que la liberté fut un chemin facile. Ce n’est pas qu’une question de frontières, de régime politique ou de barbelés. C’est un travail, un long processus intérieur. Comment être libre si on est lesté par la haine ? Comment atteindre la paix si la colère te réveille, si l’amertume t’empoisonne ? » Il lui a fallu du temps. Sa foi chrétienne l’a aidée. Et elle s’est enfin délestée du fardeau. Le chemin de la paix et de la liberté était à ce prix. Et c’est là son message.