GRAND ENTRETIEN – L’écrivain Thomas Chatterton Williams raconte dans un essai – « Autoportrait en noir et blanc: désapprendre l’idée de race »- sa quête d’identité en tant que métis dans une Amérique obsédée par le racisme. Au Figaro, l’Américain vivant en France confie son attachement à l’option française. En refusant la hantise de la couleur de peau, la France permet une certaine forme de liberté, juge-t-il. Il exprime aussi ses inquiétudes à propos de la puissance du mouvement «woke» aux États-Unis.
article par Eugénie Bastié publié sur le site lefigaro.fr, le 10 02 2021
 ________________________________________
________________________________________
Thomas Chatterton Williams est un écrivain américain. Son essai Autoportrait en noir et blanc: désapprendre l’idée de race, vient d’être traduit en français chez Grasset.
________________________________________
LE FIGARO. – Dans votre livre Autoportrait en noir et blanc, vous évoquez votre parcours de métis aux États-Unis et en France. Vous racontez notamment comment la naissance de votre fille a bouleversé votre rapport à l’identité. Pourquoi?
Thomas CHATTERTON WILLIAMS. – Ma mère est blanche, mon père est noir. Mais en Amérique, cela compte différemment. On dit qu’une goutte de sang noir suffit à faire de vous un Noir. Et ce n’est pas qu’une coutume, c’était dans la loi des États esclavagistes du Sud. On pouvait vous attribuer la «race» de votre mère, afin que les enfants illégitimes des esclavagistes conçus avec leurs esclaves ne puissent pas hériter. Et cela produisait plus d’esclaves. Ça a commencé comme ça.
Puis c’est devenu un moyen pour la communauté noire de créer une forme de solidarité. Avoir un de vos parents blancs ne faisait pas de vous un Blanc. J’ai donc grandi dans l’idée que l’on était soit noir soit blanc. Pour moi il était évident que mes enfants seraient noirs, ce serait pour eux une sorte d’obligation morale pour honorer leurs ancêtres.
Et puis ma fille est née, et je l’ai tenue dans mes bras et ramenée à la maison. Et la fiction raciale que je m’étais racontée, toute cette mythologie autour de la goutte de sang, tout ça s’est écroulé. Mon père est noir, ma fille est blanche, blonde aux yeux bleus, je suis quelque chose entre les deux. Toutes les frontières sont tombées. C’est comme si j’avais cessé brutalement de croire à l’existence du Père Noël. J’ai commencé à me demander: noir, blanc, pourquoi tenons-nous tant à ces distinctions?
Avez-vous trouvé la réponse?
Ces cases, noir, blanc, proviennent de l’histoire de l’esclavage. Ce sont des concepts abstraits, produits par l’exploitation née de la collision de l’Afrique et de l’Europe dans le nouveau monde. Mais je crois que vous n’en finirez pas avec cette dynamique de racisme en renforçant ces concepts de races noire ou blanche qui n’existent pas d’un point de vue scientifique.
Avez-vous vécu le racisme aux États-Unis? Diriez-vous pour autant que votre pays est profondément raciste?
Oui, j’ai fait l’expérience du racisme, mais non, je ne dirais pas que les États-Unis sont profondément racistes. Notre pays est immense, hypocrite, paradoxal et très complexe. Il y a du racisme. Il y a de la violence policière. Mon frère a eu les dents cassées par un policier. Mais ma vie n’est pas définie par le racisme. J’ai grandi dans une Amérique différente de celle de mon père, et qui a fait plus que n’importe quelle société pour transcender les «péchés» du passé. L’Amérique a fait beaucoup pour ouvrir sa société. J’ai eu des opportunités dans ma vie que mon père n’a pas eues. C’est pourquoi je suis très frustré quand on présente l’Amérique comme une société suprémaciste blanche. C’est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne pense pas que l’Amérique soit irrémédiablement raciste et que les Noirs soient des victimes par essence.
Vous avez des ancêtres qui furent esclaves. Pensez-vous que la mémoire de l’esclavage est assez prise en compte?
C’est délicat. L’histoire de l’Amérique a été pendant longtemps mal enseignée aux États-Unis. Il y a eu un désir de faire passer les choses pour «moins pires» que ce qu’elles étaient – du genre «les esclaves étaient heureux». Il est important de dire la vérité historique, le fait que notre pays a été construit sur plusieurs types d’inégalités, dont l’esclavage.
Mais il est très difficile de proposer une lecture simpliste de l’Amérique. Il y a eu des esclavagistes noirs, par exemple, des esclaves affranchis devenus eux-mêmes propriétaires d’esclaves. Il y a un danger aujourd’hui, une sorte de panique morale et de fétichisation de l’oppression, un récit victimaire qui voue les gens à gratter leurs plaies plutôt qu’à avancer. C’est une chose de regarder vers le passé, c’en est une autre de le comprendre avec précision. Et c’en est encore une troisième d’arriver à trouver un chemin pour que la société multiethnique surgie de ce passé puisse vivre ensemble dans le futur. Or j’ai l’impression que nous sommes aujourd’hui sur un tapis roulant, à courir sans aller nulle part.
En France j’ai l’impression de quitter le psychodrame racial que traverse l’Amérique pour exister dans une société qui se considère comme aveugle à la couleur de peau. Et c’est vraiment une libération.
Vous luttez contre le déterminisme. Mais comprenez-vous que cela ne soit pas si facile?
Oui, nous avons tous des histoires, des communautés. Je viens d’un milieu assez spécial, mixte et mobile, mais j’ai bien conscience que nous ne sommes pas des pages blanches. Évidemment que le poids du passé nous imprègne, ce qui s’est passé aux États-Unis pendant l’esclavage, en Algérie pendant la colonisation, pèse aujourd’hui, et on ne peut pas balayer cela d’un revers de main. Mais j’aime beaucoup cette phrase de Camus: «La misère m’empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l’histoire ; le soleil m’apprit que l’histoire n’est pas tout.» Or, depuis 2013-2014, en Amérique, on s’est mis à croire que l’histoire était tout. Et on ne se rend même plus compte que le soleil continue de briller.
Je vous l’ai dit, mon frère s’est fait battre par des policiers. C’était terrible, vraiment. C’est arrivé. Mais ça ne constitue pas la totalité de sa vie. De même que les Noirs qui se font tuer par la police aux États-Unis ne constituent pas la réalité quotidienne des 44 millions de Noirs américains. Il y a un récit qui dit aux Noirs que l’histoire les agresse sans cesse, que dès qu’ils mettent un pied dans la rue ils sont en danger. Paradoxalement, cela renforce même la suprématie blanche en faisant croire aux Blancs racistes à leur toute-puissance.
Vous comparez dans votre livre la France et l’Amérique, et vous dites que la France a été un sanctuaire pour les Noirs américains. Pourquoi?
Les premiers Afro-Américains sont venus en France dans les années 1800. C’était de riches Créoles de Louisiane, qui n’étaient toujours pas considérés comme blancs aux États-Unis et mettaient leurs enfants à l’école en France, où ceux-ci étaient traités avec la dignité due à de riches bourgeois. En France, l’obsession de la couleur de peau n’existait pas. Puis vous avez eu les soldats noirs américains pendant la Première Guerre mondiale, qui ne voulaient pas rentrer car ils étaient bien mieux traités en France qu’aux États-Unis. Ensuite, les artistes et les écrivains comme Chester Himes, Richard Wright ou James Baldwin, qui a bien parlé de cette impression de liberté qu’il trouvait en France. Entre les Blancs français et les Noirs américains, il n’y a pas d’histoire de colère et de ressentiment. En France, j’ai l’impression de quitter le psychodrame racial que traverse l’Amérique pour exister dans une société qui se considère comme aveugle à la couleur de peau. Et c’est vraiment une libération.
Que pensez-vous des critiques adressées à la France pour son manque de considération pour les questions raciales?
J’ai de la sympathie pour l’option française, même si je ne pense pas que votre pays soit une société idéale, non raciste. Il y a du racisme en France, mais la France a des valeurs et une manière particulière de concevoir une société multiethnique qui me semble un avantage par les temps qui courent. Vous seriez fous de regarder l’Amérique d’aujourd’hui et de vous dire: «Nous devrions faire pareil.» L’Amérique souffre d’une terrible maladie raciale, et l’aveuglement aux couleurs de la France est en théorie une très bonne chose. Même si, parfois, elle vous empêche de voir certaines réalités. Par exemple, vous ne connaissez pas la couleur de peau de votre population carcérale, ce qui vous empêche de quantifier certains problèmes sociaux.
Que pensez-vous du mouvement «woke»?
Je pense que ce qu’on appelle le Great Awokening (le «grand éveillement», mouvement progressiste militant qui consiste à mettre systématiquement en avant le racisme et les discriminations, interprétés de façon très étendue) est une erreur morale et philosophique. Nous ne devrions pas nous définir par les fautes ou les blessures de nos ancêtres. Quand vous avez un mouvement, comme le mouvement «woke», qui est embrassé si facilement par Fortune 500 (les 500 plus grandes entreprises, équivalent américain du CAC 40), par toutes les institutions artistiques majeures, tous les journaux mainstream, n’importe lequel des magazines littéraires, cela signifie que ce mouvement ne remet rien en question. Il ne change pas vraiment la société.
Regardez ce qui s’est passé quand Bernie Sanders a essayé de parler de l’augmentation du salaire minimum, de la création d’une véritable sécurité sociale: tout l’establishment qui trouve aujourd’hui Kamala Harris formidable, parce qu’elle est la première vice-présidente femme, l’a mis à terre. Parler sans cesse de genre, de sexualité et de race ne remet en aucune manière en cause les élites.
L’idée de «privilège blanc» est-elle pertinente?
Je pense que l’idée de la «blancheur» (whiteness), comme point de départ neutre et invisible à partir duquel le reste de la population devait se définir, était une réalité pour les gens de la génération de ma mère et des précédentes. C’est un fait que dans l’American way of life la blancheur était considérée comme la norme. C’était une réalité issue d’une énorme majorité démographique.
Mais je n’aime pas le terme de «privilège blanc». C’est affirmer que le fait de ne pas être discriminé n’est pas la norme mais un privilège, et qu’il faut donc l’enlever à ceux qui en bénéficient. Il y a deux manières d’arriver à l’égalité: hisser ceux qui sont en bas vers le haut ou faire baisser ceux qui sont en haut. Je crois qu’en Amérique aujourd’hui on pratique la seconde option. Certains intellectuels vont jusqu’à dire que le mérite est une forme de racisme! Aux États-Unis, nous employons souvent le mot «race» pour ne pas dire classe sociale, et nous ne voyons pas que de nombreux Blancs ont sombré dans la pauvreté que vivaient déjà de nombreux Noirs aux États-Unis.
La guerre civile est au cœur même de l’Amérique blanche, entre une Amérique blanche qui embrasse la thèse de la «fragilité blanche» (white fragility), pense qu’elle a été très mauvaise et qu’elle doit maintenant expier, et une autre Amérique blanche qui se dit, puisque tout le monde parle d’identité, «vous savez quoi, nous en avons une aussi, nous sommes blancs». Comme le dit mon ami Glenn Loury (professeur de sciences sociales et d’économie à l’université Brown, à Rhode Island, NDLR), l’épée de l’identité est une arme qui peut être ramassée et brandie par tout le monde. Je crois que quelqu’un va devoir déposer l’épée si nous voulons avoir un meilleur avenir qu’aujourd’hui.
« Aux États-Unis, aucun autre groupe racial n’a une vue aussi défavorable des Blancs que les Blancs eux-mêmes. C’est fou ! »
Thomas Chatterton Williams
D’ailleurs, une partie certes minoritaire des Noirs américains a voté Trump…
Oui, et des Latinos aussi. Les Blancs progressistes sont plus «woke» que les minorités, qui sont par ailleurs souvent conservatrices sur l’immigration, le mariage homosexuel ou même la police. Les Blancs progressistes sont le seul groupe à avoir une vue défavorable de lui-même: pire, aucun autre groupe racial n’a une vue aussi défavorable des Blancs que les Blancs eux-mêmes. C’est fou. Dans le Washington Post, récemment, il y a eu une tribune disant que les gens comme moi, qui n’adhéraient pas au récit «woke», participaient d’une «blanchité multiraciale». Nos opinions font de nous des «Blancs». Vous voyez où nous en sommes.
Dans votre livre « Autoportrait en noir et blanc: désapprendre l’idée de race », Vous racontez l’espoir qu’a suscité chez vous Obama et son rêve de société post raciale. Pourquoi cet espoir a-t-il été déçu?
Parce que c’était une utopie. Avec Obama, son histoire personnelle, son élégance, son incroyable ascension, nous nous sommes 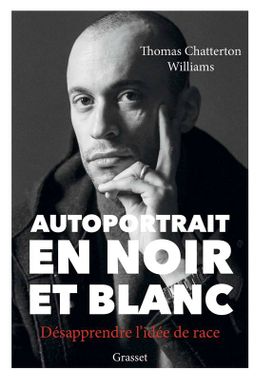 raconté une histoire à laquelle nous voulions croire, qu’élire cet homme serait le climax de notre histoire, de notre rêve américain, la résolution de tous nos problèmes. Bien sûr, c’était trop. Un homme seul ne peut pas réparer la société. Il a été élu président l’année où Facebook a commencé son envol. Il était au pouvoir mais, sur les réseaux sociaux, on voyait des vidéos d’enfants noirs tués par la police filmés par des smartphones munis de bonnes caméras. Obama était président, mais ça arrivait encore. Le décalage a paru insupportable.
raconté une histoire à laquelle nous voulions croire, qu’élire cet homme serait le climax de notre histoire, de notre rêve américain, la résolution de tous nos problèmes. Bien sûr, c’était trop. Un homme seul ne peut pas réparer la société. Il a été élu président l’année où Facebook a commencé son envol. Il était au pouvoir mais, sur les réseaux sociaux, on voyait des vidéos d’enfants noirs tués par la police filmés par des smartphones munis de bonnes caméras. Obama était président, mais ça arrivait encore. Le décalage a paru insupportable.
Que pensez-vous de la situation actuelle de l’Amérique? Pensez-vous que Joe Biden soit à même de réconcilier le pays?
Je suis moins optimiste qu’il y a trois mois. Je pensais comme beaucoup que pour contrer les excès de la «woke culture» il fallait voter Biden. Trump ne fait que la renforcer par mimétisme. Mais le fait est que Joe Biden ne parvient pas à la contenir. Peut-être que personne ne peut. La boîte de Pandore est ouverte, on ne peut plus la refermer. Pas après ce qui s’est passé le 6 janvier dernier au Capitole avec l’insurrection de trumpistes. Alexandria Ocasio-Cortez (représentante démocrate très appréciée par la base «woke») ne manque pas de rappeler dès qu’elle le peut qu’elle a failli être tuée ce jour-là. Après cela, Trump peut mourir, ce sera la justification pour tous les délires «woke» pour les dix ans à venir. Le backlash (le «contrecoup») a déjà démarré et il ne pourra pas être stoppé avant très longtemps.
Autoportrait en noir et blanc: désapprendre l’idée de race, Thomas Chatterton Williams, 224 p., 19,50 €. Grasset








