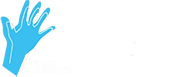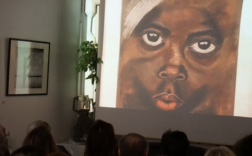L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) est un service à compétence nationale rattaché au ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, qui agit comme observatoire des questions liées à la jeunesse, l’éducation populaire, la vie associative et le sport. Julie Couronné, sociologue et chargée de recherche à l’INJEP, a publié de nombreux travaux sur les questions liées à l’insertion des jeunes. Nous avons eu l’opportunité d’échanger avec elle.
Dans plusieurs entretiens vous pointez les difficultés spécifiques des jeunes demeurant dans les quartiers politiques de la ville, qu’en est-il des personnes en zones rurales ?
JC : Mon champ d’expertise concerne principalement les QPV (Quartier prioritaire de la politique de la ville) , les centres urbains ou les zones périurbaines. Les zones périurbaines sont des zones où l’on ne sait pas toujours si l’on est en milieu urbain ou en milieu rural. Ces zones rencontrent parfois des problèmes similaires à ceux des territoires ruraux. Par exemple les jeunes locataires d’un FJT situé dans une zone industrielle, sont confrontées à une offre de transports en commun existante, mais peu adaptée : des horaires inappropriés pour certains contrats, des trajets souvent complexes, un accès limité aux petits commerces et aux services publics… Sans voiture, la mobilité devient une véritable épreuve, comme c’est souvent le cas en milieu rural. L’impact du territoire est notable : l’espace-temps dans lequel s’inscrit la personne en précarité va avoir une influence sur sa manière de percevoir et d’interagir avec les institutions.
L’État multiplie les dispositifs d’accompagnement vers les jeunes, mais les publics les plus éloignés semblent toujours « invisibles, pourquoi ?
JC : Quantifier leur nombre reste très compliqué : les approches varient rendant difficile l’adoption d’une technique de comptage fiable et universelle. Pourtant, ces dispositifs « aller vers » sont non seulement légitimes, mais essentiels pour répondre aux besoins de ces jeunes.
À l’opposé, il existe une autre catégorie de jeunes qui peuvent être qualifiés d’« ultra-visibles », car ils ont été suivis par différents intervenants tout au long de leur parcours. Ces jeunes peuvent traverser des dispositifs multiples : de l’aide sociale à l’enfance, ils passent par des foyers de jeunes travailleurs, puis intègrent les missions locales.
Parfois des situations sont tellement dégradées que les institutions rencontrent des difficultés à trouver des solutions, certains jeunes n’en peuvent plus de passer d’une structure à une autre et expriment alors une saturation d’être pris en charge. Cette saturation peut entraîner des comportements de rejet : certains renoncent même à des droits essentiels, comme la sécurité sociale, pour échapper à ce qu’ils considèrent comme un contrôle, pour ne plus rien devoir à personne et échapper aux regards des intervenants. Ce n’est pas sans risque.
Toutefois, la majorité des jeunes restent reconnaissants des aides qu’ils reçoivent. La critique de l’institution ne concerne qu’une minorité, mais elle illustre des potentielles failles dans le système, notamment dans sa capacité à offrir des réponses adaptées aux besoins diversifiés des publics jeunes.
Les politiques publiques ne peuvent pas se satisfaire de cette situation. Que peuvent apporter les chercheurs dans ce contexte ?
JC : Dans ma thèse en sociologie sur la prise en charge des enfants absentéistes, j’ai étudié les situations les plus dégradées. Ce travail a révélé qu’autour de ces jeunes en rupture se constitue un véritable maillage d’intervenants et d’intervenantes : psychologues scolaires, assistantes sociales et infirmieres scolaires, conseillers principaux d’éducation (CPE), travailleurs sociaux de la protection de l’enfance, etc. Ces personnels sont essentiels pour repérer ces jeunes vulnérables. Cependant, ils sont de moins en moins nombreux. Cela pose un problème majeur, car moins de personnels signifient moins de repérages. Les établissements scolaires jouent donc un rôle crucial dans ce processus, avec une fonction de repérage indispensable, mais le manque de moyens peut affaiblir son efficacité.
La mobilité reste un enjeu majeur pour les jeunes vivant en milieux ruraux, en particulier face à l’éloignement des services publics, d’une offre de formation insuffisante, d’un emploi éloigné. C’est eux qui forment les gros bataillons des « invisibles » ?
JC : Ce que montrent les travaux, c’est qu’il y a ceux qui restent et ceux qui partent. On part pour avoir accès à tous les services et quand on reste, on fait le choix d’aspirations et d’opportunités plus limitées. L’aide à la mobilité, bien qu’existante, reste insuffisante. Par exemple, il existe de nombreuses aides pour financer le permis de conduire, ce qui est une bonne chose, mais cela ne résout pas entièrement le problème. Pour les personnes en situation de précarité, y compris les travailleurs pauvres, obtenir le permis ne suffit pas : elles n’ont souvent pas les moyens d’acheter une voiture, de souscrire à une assurance, ou d’assumer les coûts d’entretien. Face à une situation financière difficile, un accident et tout s’écroule… Ces couts seront souvent sacrifiés au risque de s’isoler. La catégorie des « invisibles » qu’on associe souvent à celle de Neet (ni en emploi ni en formation) a ses limites : la catgéorie de neet catégorise un jeune à un moment précis, sans tenir compte de son parcours. Par exemple, dans le cadre de la Garantie Jeunes qui ciblait les « neets vulnérables » certains jeunes ont déjà travaillé, mais pas dans un cadre légal (aider un oncle sur un marché par exemple). C’est un public très hétérogène, on retrouve des jeunes diplômés de grandes écoles, qui sont certes sans emploi ni formation, mais qui ne resteront pas longtemps dans cette situation. Cette catégorie regroupe des réalités très différentes.
Que pensez-vous de la multiplication des dispositifs publics vers ces jeunes ?
JC : Il y a un impératif de coordination. Chaque dispositif a son intérêt. Mais parfois le « millefeuille du service », rend l’offre difficilement lisible. Cela peut complexifier l’accès aux dispositifs pour les jeunes et, paradoxalement, les éloigner ou les perdre. En entretien, il est fréquent qu’un jeune ne puisse pas nommer les dispositifs qui l’accompagnent, ni les rôles des différents intervenants. Par exemple, dans un parcours en SEGPA, il arrive que le jeune ne comprenne pas pourquoi il a été orienté dans ce cadre. Donc il est nécessaire que la multiplication des intervenants et des dispositifs n’engendre pas une perte d’information essentielle pour le jeune qui doit rester acteur de son destin.
Découvrez d’autres article à propos des personnes éloignées de l’emploi :
– Les personnes éloignées de l’emploi : des centaines de milliers d’invisibles ? On fait le point.