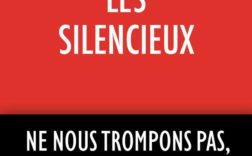Alors que le professeur d’allemand Klaus Kinzler, lui aussi qualifié d’ « islamophobe » et de « fasciste » sur le mur de l’Institut d’Etudes Politiques – Sciences Po Grenoble – le 4 mars dernier, s’est exprimé généreusement – y compris dans nos pages – sur cette sinistre affaire, l’autre enseignant visé, Vincent Tournier(1), s’est fait plus discret. Maître de conférences en science politique, spécialiste des attitudes politiques et de l’opinion publique, auteur d’un Portrait des musulmans d’Europe pour la Fondapol, il ne cache pas sa liberté de ton et son amour du débat. C’en est visiblement trop pour une minorité d’étudiants et d’enseignants capables de museler et même terroriser une majorité qui ne trouve pourtant rien à redire à sa démarche. Placé sous protection policière, touché par cette dénonciation publique, mais certainement pas coulé, Tournier revient sur ces événements et plus généralement sur la situation des sciences sociales en France.
Propos recueillis par Laetitia Strauch-Bonart et publiés sur le site lepoint.fr, le 16 03 2021
Le Point : Vous dispensez depuis plusieurs années à l’IEP Sciences Po Grenoble un cours sur l’islam et les musulmans en France. Pourquoi ?
Vincent Tournier : Le cours en question est optionnel, ce qui permet déjà de souligner le caractère délirant de ce qu’il se passe. J’ai proposé cet enseignement en 2014, à une époque où je voyais bien qu’il se passait des choses très importantes sur le sujet de l’islam, dans un contexte d’indifférence de la part des médias mais aussi des universitaires. Les attentats qui ont suivi en 2015-2016, ainsi que la polarisation croissante de la société française sur ces questions, m’incitent à penser que je n’avais pas totalement tort.
Ces événements dramatiques ont aussi eu un revers. Le contexte s’est considérablement durci. Un climat de peur s’est également imposé après 2015. Tout ceci a créé une puissante incitation au silence. Dans un tel contexte, mon cours apparaît alors comme quelque chose d’incongru : pourquoi parler de tout ceci ? Vouloir aborder ces questions sur un campus, c’est déjà presque une forme de dissidence. Et puis l’énervement de certains étudiants est certainement renforcé par mon image personnelle. J’ai la réputation de parler franchement, librement, avec un côté provocateur que j’assume. Contrairement à la tendance actuelle des universités, qui considèrent que les étudiants doivent être choyés et protégés de toute « agression » verbale, je pense au contraire qu’elle doit rester le lieu où on doit bousculer les évidences et les dogmes, quitte à choquer. Naturellement, si je revendique une absolue liberté de ton et de parole, j’accorde la même liberté aux étudiants. La relation pédagogique n’est pas symétrique, mais je ne suis pas mesquin au point de les évaluer en fonction de mes idées.
En février dernier, l’Union syndicale, seul syndicat étudiant de l’IEP, a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour encourager les étudiants à trouver dans votre cours des preuves de votre « islamophobie ». Comment avez-vous réagi ?
Je ne savais pas que j’étais surveillé. Manifestement, pour certains étudiants, c’est l’existence même de ce cours qui semble être un problème. Voici quelques années, j’avais déjà été pris à partie par l’Unef. Un de mes collègues m’avait dit : « Mais si tu es visé par l’Unef, c’est bon signe, ça veut dire que tu penses. » Cela avait effectivement un côté amusant. Mais aujourd’hui, avec les risques sécuritaires, la situation est totalement différente. Il me semblait néanmoins que ce genre de réaction était derrière nous, surtout après l’assassinat de Samuel Paty. Du reste, le fait que l’Union syndicale ait dû lancer un appel à témoignages deux mois après la fin du cours (puisqu’il a eu lieu entre septembre et décembre, sans que les étudiants présents aient fait la moindre remarque) m’incite à penser qu’ils ont dû être terriblement déçus de ne rien avoir à se mettre sous la dent.
Lorsque j’ai appris par un étudiant, le lundi 22 février au soir, que je faisais l’objet de commentaires haineux sur les réseaux sociaux, j’ai évidemment été surpris mais je n’ai pas pris immédiatement la mesure du problème. Ce n’est que lorsque j’ai compris qu’il y avait une demande d’interdiction de mon cours par le syndicat ainsi qu’un appel public à témoignages sous l’accusation d’islamophobie que j’ai ressenti le désir de réagir. Ma colère s’est doublée d’un sentiment d’effroi face à une accusation qui, dans le contexte post-Samuel Paty, équivaut à un appel au lynchage. Nous étions le jeudi et la décision devait être votée le vendredi par le Cevi (Conseil des études et de la vie étudiante). Et le vendredi matin, je devais aller en cours. Pour moi, il était inenvisageable de faire cours avec le risque de me retrouver en présence d’étudiants qui aspiraient à supprimer mon enseignement et à mettre ma vie en danger. Le jeudi soir, j’ai envoyé un message à toutes mes classes pour inviter les étudiants concernés à quitter immédiatement mes enseignements du second semestre (et non mon cours sur l’islam, contrairement à ce qui a été dit). J’apprendrai plus tard que le syndicat a déposé une plainte contre moi pour discrimination syndicale, plainte qui a été classée sans suite. Toujours est-il que, à ma grande joie, très peu d’étudiants ont été concernés (deux à ma connaissance). Tous les autres étaient présents en cours et ont manifestement compris ma réaction. Dans les jours qui ont suivi, j’ai reçu beaucoup de témoignages d’étudiants pour me faire part du climat très malsain instauré à l’IEP par une minorité d’activistes. C’est une triste réalité que j’ai découverte à cette occasion.
Depuis les événements du 4 mars, comment jugez-vous l’attitude de vos collègues et de la direction ?
La directrice de l’IEP a toujours soutenu la liberté d’expression et la diversité des points de vue. Sur ce plan, elle est irréprochable. Mais il est vrai que, récemment, la communication a été défaillante et maladroite. Très maladroite, même, puisque la directrice a laissé entendre qu’elle nous désavouait, Klaus Kinzler et moi, ce qui n’est pas le cas. Des rectifications vont certainement arriver, du moins je l’espère parce qu’il ne faut pas rester dans une telle ambiguïté.
Du côté de mes collègues, je pense qu’ils sont horrifiés par les appels à la délation et au lynchage, ainsi que par le placardage sur les murs de l’IEP. On n’a jamais vu ça à l’IEP. Néanmoins, beaucoup d’enseignants n’osent pas se situer clairement. Il faut dire que, en plus du climat de peur générale, les pressions sont très fortes, tant de la part des étudiants que de certains collègues qui considèrent que, finalement, Klaus et moi avons bien mérité ce qui nous arrive. Pour ces derniers, comme pour de nombreux universitaires, les minorités sont d’abord des victimes d’un État oppresseur et la priorité est donc de les protéger, de sorte que toute critique est soupçonnée de vouloir aggraver une certaine domination.
C’est ce qui explique que les communiqués officiels ne sont pas toujours très clairs. Le conseil d’administration de l’IEP évoque par exemple son attachement au « respect des règles établies et légitimes de l’échange académique », formule très alambiquée, et appelle « au respect du devoir de réserve par les enseignant•es et les enseignant•es-chercheur•es de l’établissement ainsi que de la liberté syndicale ». Outre le recours à l’écriture inclusive, désormais systématique sur les campus, je m’interroge sur cette formule du « devoir de réserve » dont j’attends qu’on m’explique de quelle façon il s’applique aux enseignants-chercheurs. Quand on connaît l’extrême degré de politisation des universitaires, cela prête même à sourire. Pour ce qui me concerne, je n’appartiens à aucun parti, à aucun syndicat, à aucun groupe militant, et je n’ai jamais appelé à voter pour qui que ce soit, contrairement à de nombreux collègues.
Continuez-vous vos cours ?
Absolument. Je ne vous cache pas qu’il est un peu difficile de se concentrer dans ces conditions mais je ne veux surtout pas renoncer à ma mission ni laisser croire que je serais atteint d’une manière ou d’une autre. Je n’ai rien à me reprocher. Je retrouve donc avec plaisir mes étudiants : nous travaillons, ils font leurs exercices, je les évalue. Je leur ai dit que je ne parlerais pas de l’affaire pendant les séances et je m’y tiens. Je leur dois de tenir bon pour ne pas gâcher leur année. Je pense qu’ils n’ont pas envie que tout s’arrête à cause d’une bande d’énergumènes qui se croient autorisés à contrôler le contenu des enseignements et à placarder les noms de dissidents, comme cela se faisait à l’époque de dazibao de la Révolution culturelle chinoise. La technologie change mais pas les méthodes.
« Les universitaires ne peuvent pas faire naïvement comme si certains concepts n’étaient pas surchargés sur le plan politique. »
Vous vous intéressez depuis longtemps à l’« islamophobie ». Que pensez-vous de ce concept ?
Chacun est libre d’utiliser les mots qu’il veut, mais les universitaires ne peuvent pas faire naïvement comme si certains concepts n’étaient pas surchargés sur le plan politique. Le terme d’islamophobie pose cinq problèmes. Il désigne des réalités très différentes puisqu’il englobe les agressions contre les personnes (ce qui est intolérable mais très rare) et les critiques de la religion musulmane (ce qui est une attitude légitime). Deuxièmement, l’islamophobie instaure une chape de plomb intellectuelle puisqu’il crée un soupçon sur toute critique et décourage toute analyse, y compris sur le dogme islamique lui-même. Après tout, est-on islamophobe lorsqu’on pense que le Coran n’a pas été dicté par Dieu ? Ou bien lorsqu’on publie une caricature de Mahomet ? Ou lorsqu’on critique l’islamisme ? Ou lorsqu’on veut comprendre la radicalisation ? Troisièmement, l’islamophobie oblige à amalgamer les musulmans dans un même ensemble, empêchant de tracer une ligne entre les valeurs ou les pratiques qui sont parfaitement acceptables et d’autres qui ne le sont pas. Quatrièmement, c’est une notion qui est promue par des acteurs troubles, tant au niveau international qu’au niveau national, comme dans le cas du CCIF dont le but est visiblement de dresser une vision apocalyptique de la situation des musulmans en France afin d’empêcher l’intégration de ces derniers dans la société française et d’interdire toute réflexion sur les causes de la radicalisation. Cinquièmement, enfin, ce terme met totalement de côté l’existence en France d’un courant islamophile qui est au moins aussi puissant que le courant critique envers l’islam. Gommer cette réalité conduit à ne rien comprendre à la situation actuelle. Bref, pour toutes ces raisons, je pense que les conditions ne sont pas réunies pour utiliser sereinement un tel terme.
Certaines sciences sociales tendent-elles à faire passer leur militantisme pour de la science ?
Il y a toujours eu des passerelles entre les sciences sociales et l’engagement politique, mais il me semble effectivement que, au cours du temps, l’activisme et le militantisme sont devenus plus saillants. De nombreux enseignants-chercheurs sont eux-mêmes engagés dans des collectifs ou des actions politiques. Ils ont tendance à voir les sciences sociales comme un instrument au service de leur projet de transformation de la société, ce qui vient brouiller la dimension scientifique des sciences sociales. On observe aussi une certaine radicalité dans la manière dont les idées sont défendues. L’humour et le second degré sont désormais exclus. Sur les listes de diffusion professionnelles, les voix discordantes sont très mal perçues et tout désaccord débouche rapidement sur des invectives personnelles, ce qui est un comble pour un milieu qui entend donner des leçons de civisme au monde entier.
Le plus étrange est que les sciences sociales refusent d’appliquer à elles-mêmes les théories explicatives qu’elles élaborent, par exemple sur les effets de groupe ou sur le conformisme. Il suffit pourtant de circuler dans des colloques universitaires pour comprendre que les groupes de travail se forment par affinité. Les universitaires dénoncent volontiers les discriminations chez les autres mais ils ne sont pas les derniers à pratiquer une certaine sélection culturelle et idéologique.
On sait aussi que chaque groupe produit sa propre « spirale du silence », ce qui signifie que les voix minoritaires ont tendance à se taire pour éviter l’exclusion. Les effets d’éviction sont encore plus forts lorsque le groupe se dote d’un projet moral. Quand vous avez des chercheurs qui conçoivent leurs projets de recherche comme un instrument pour sauver une catégorie de personnes jugées opprimées, la critique devient vite difficile, voire impossible. Je ne cherche évidemment pas à légitimer les discriminations, mais une règle de base de la sociologie est d’expliquer les choses, non de les juger.
Quelles sont les raisons de cette radicalité ?
Une explication possible se trouve dans l’échec politique d’une certaine gauche radicale, qui n’a pas réussi à se relancer après la crise financière de 2007-2008, et qui a sans doute le sentiment que l’opinion publique lui échappe de plus en plus. Il faut aussi tenir compte d’une certaine réalité sociale. Les métiers de la recherche se sont précarisés ; beaucoup de jeunes chercheurs ont le sentiment d’être exploités, ils enchaînent les vacations et les petits jobs sans voir le bout du tunnel et sans être assurés de leur avenir. Cette situation accroît le ressentiment et rend davantage réceptif aux discours revendicatifs. Il serait peut-être bon de donner de meilleures conditions de travail aux doctorants, quitte à en réduire le nombre.
De quand peut-on dater ce phénomène ?
Il y a vraisemblablement une conjonction de facteurs : le contexte post-colonial et le sentiment de culpabilité, le déclin des grands récits et du roman national, la démocratisation scolaire, la consécration des droits individuels. La fin de la guerre froide et la mondialisation ont laissé la gauche révolutionnaire orpheline et désespérée. Les universités se sont lancées dans la globalisation. La circulation des enseignants et des étudiants s’est accrue. Résultat : les enseignants-chercheurs ont commencé à faire des colloques aux quatre coins du monde, constituant des réseaux de relations extrêmement riches. Mais il y a eu un revers à cette médaille. Le niveau des études a baissé, ce qui est logique puisque, quand vous vous retrouvez avec des étudiants étrangers qui maîtrisent mal la langue et la culture, vous êtes obligé de réduire vos ambitions et de passer du temps à expliquer des choses qui sont assez banales pour les Français. Par ailleurs, le seuil de sensibilité et de tolérance a baissé, ce qui est là encore logique puisque, selon les pays, les formes de tolérance ou d’intolérance ne sont pas les mêmes. Par exemple, la loi de 2004 sur l’interdiction des signes religieux dans les écoles, considérée chez nous comme une loi d’émancipation, est vue par les étudiants étrangers comme une discrimination épouvantable. Et je ne parle pas de l’humour parce que, évidemment, tout le monde ne rit pas des mêmes choses. De ce fait, l’enseignement devient un champ de mines. Il faudra un jour régler ce problème. Je suggérerais volontiers que, par exemple, chaque étudiant qui accède à l’enseignement supérieur signe une charte disant qu’il accepte d’entendre des opinions discordantes. Les études sur les discriminations n’ont débouché sur aucun résultat tangible, sinon la création de normes morales qui empêchent de penser la réalité.
Comment « sauver la recherche », la rendre plus neutre et surtout faire accepter la nécessité du débat contradictoire ?
On peut engager un débat sur deux niveaux, du moins pour les sciences sociales et politiques. Le premier concerne ce que l’on pourrait appeler la culture de la recherche. Nous devons revenir aux fondamentaux. Trop de recherches privilégient des micro-objets sans intérêt, ou des objets trop idéologiques, au détriment des grands enjeux. Les études sur les discriminations n’ont débouché sur aucun résultat tangible, sinon la création de normes morales qui empêchent de penser la réalité. Il faut donc revenir aux grandes questions qui occupent la société et le faire en développant, autant que possible, des approches quantitatives. Nous avons besoin d’enquêtes lourdes, documentées, sérieuses, ce qui implique de renforcer la place des méthodes statistiques dans les cursus, meilleur moyen pour limiter les discours farfelus ou idéologiques.
Le second niveau concerne la gouvernance des universités et des centres de recherche. Les universitaires sont très attachés, à juste titre, à des recrutements et des évaluations qui passent par les pairs. Idéalement, c’est évidemment ce qu’il faut faire. Mais la gestion par les pairs ne marche que si les individus sont éthiquement irréprochables, s’ils sont portés par une forte conscience civique, ce qui n’est plus forcément le cas lorsque les réseaux militants commencent à prendre le contrôle. On peut alors se demander s’il ne faut pas commencer à réfléchir à une autre option : celle d’une recentralisation politique, avec par exemple une nomination des présidents d’université ou des centres de recherche en Conseil des ministres. Un test intéressant sera la désignation du prochain directeur de Science Po Paris. L’enjeu est très important car l’IEP de Paris a une forte responsabilité dans les dérives que nous avons connues ces dernières années. Rappelons que Science Po Paris, puis les IEP de province, ont été créés pour former les cadres de la nation. Qu’est devenue cette mission ? Les IEP forment-ils encore des cadres attachés au service public et désireux de servir passionnément leur pays ?
- Vincent Tournier est contributeur de Phébé .
Sciences Po Grenoble : « Ma colère s’est doublée d’un sentiment d’effroi » https://www.lepoint.fr/tiny/1-2418019 #Postillon via @LePoint